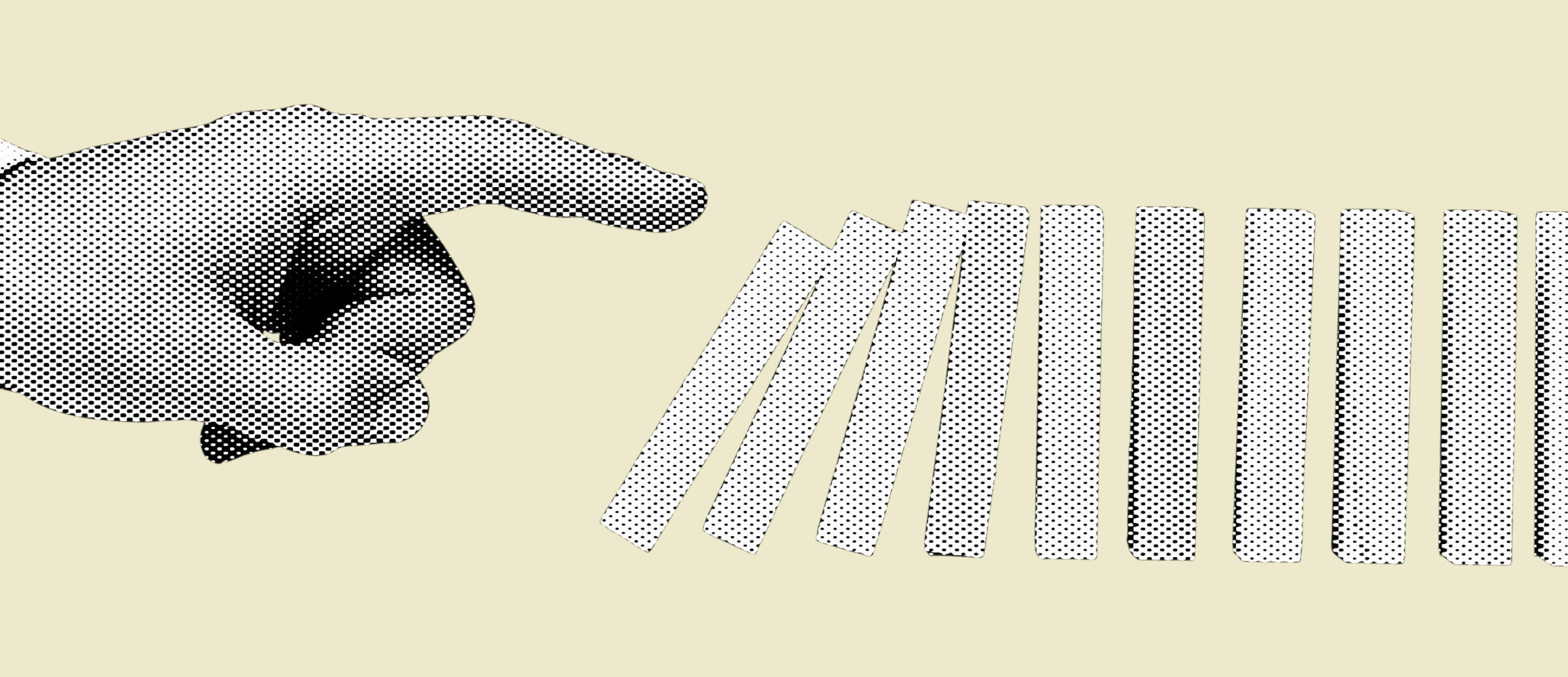
Une étude, publiée dans « Nature Climate Change », le 7 mai, met en évidence que, au niveau mondial, les 10 % les plus riches sont responsables des deux tiers du réchauffement climatique. Ou, pour présenter les choses autrement, si l’ensemble de la population avait émis autant que les 10 % les plus riches, le thermomètre aurait bondi de 2,9°C au lieu de 0,61°C entre 1990 et 2020. Cette nouvelle étude quantifie, pour la première fois, les émissions liées aux investissements des entreprises émettrices de CO2 aux actionnaires et aux épargnant·e·s, qui en détiennent les parts.
Et cela pose la question de leur responsabilité. La coexistence des individus en société entraîne en effet des dommages résultant de l’entrecroisement des activités humaines. Si nous sommes victimes d’un dommage, nous allons chercher à en effacer les conséquences. Et si nous en sommes l’auteur·rice, à le réparer. Il en va de notre responsabilité, c’est-à-dire de notre capacité d’assumer nos actes et leurs conséquences. Mais aussi de notre capacité de vivre en société car l’impunité alimente les inégalités, affecte de manière disproportionnée les plus vulnérables et sape la confiance dans les institutions politiques.
Ceci concerne aussi les dommages environnementaux engendrés par une activité polluante. Le principe du pollueur-payeur qui consiste à faire réparer ces dommages par leurs auteurs est un principe juridique et économique fondamental de la politique environnementale de l'Union européenne. Ainsi, l'extension du marché carbone européen aux secteurs du bâtiment et des transports va renchérir à partir de 2027 le prix du transport carboné d’un particulier pour le rapprocher de son coût réel, en y intégrant ses externalités, à savoir les effets générés indirectement sur l’environnement.
Par contre, le même particulier dispose d’une totale impunité s’il consacre son épargne à financer des activités polluantes. Qui sont ces détenteur·rice·s d’actifs financiers impunis ? Essentiellement les 10 % les plus riches en Belgique qui, selon les statistiques de la Banque nationale de Belgique et de la Banque centrale européenne, possèdent 79 % des actions cotées. Une autre étude avait déjà montré que la taxation des émissions liées aux actifs financiers est plus équitable qu’une taxe carbone touchant l’ensemble de la population qui, si elle n’est pas complétée par des mesures d’accompagnement, pèse sur les faibles revenus.
Il est donc essentiel et urgent de supprimer cette impunité génératrice d’irresponsabilité et d’appliquer le principe du pollueur-payeur également à celles et ceux qui détiennent les actifs financiers, sous peine de compromettre le droit d’existence de chacun.


