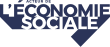En bref :
- La contestation citoyenne a permis de limiter les dégâts de Coca-Cola sur l'eau en Inde.
- En Argentine, la privatisation de la gestion de l'eau a fait exploser les prix.
Coca-Cola made in India
La multinationale Coca-Cola s'est installée pour la première fois en Inde en 1977, mais fut rapidement expulsée du pays, car elle refusait, contrairement à l'obligation légale, de publier la liste de ses ingrédients. En 1991, cette obligation tomba et Coca-Cola vint se réinstaller dans la péninsule indienne.
Dans plusieurs États indiens, les populations locales ont accusé l'entreprise d'utiliser l'eau de manière totalement déraisonnée et d'assécher les nappes phréatiques. En 2005, Coca-Cola pompait chaque jour de 1 à 1,5 million de litres d’eau(1). Au Kerala, un État du sud de l'Inde, bien que Coca-Cola ait négocié des contrats avec les autorités locales limitant les quantités d'eau qui pouvaient être extraites, la firme a très vite augmenté les pompages et creusé de nouveaux puits.
La firme a également été accusée d'utiliser de l'eau contaminée pour produire ses boissons et de ne pas la dépolluer avant de la rejeter. D’après Coca-Cola, la présence de pesticides dans les nappes phréatiques n'était pas causée directement par ses activités, mais bien par l'épandage, par les paysans, de pesticides sur les terres arables. Pourtant, la responsabilité de la société commerciale est bien établie. Jusqu'il y a peu, la multinationale vendait (puis offrait) les boues contaminées issues de la fabrication du soda aux paysans, qui s'en servaient comme engrais, ce qui avait pour effet d’aggraver le phénomène de pollution des nappes phréatiques. Un combat juridique, qui devait durer près de vingt ans, s’est alors engagé entre la population locale, soutenue par les autorités régionales, et la compagnie.
Victoire citoyenne
Depuis 2000, des femmes du Kerala se sont organisées pour lutter contre l'entreprise. Des paysans ont porté plainte et exigé de Coca-Cola la protection des sources d’eau potable, des mares et des réservoirs ainsi que l’entretien des voies navigables et des canaux en contrepartie des dégâts causés par l'entreprise. Les tribunaux locaux du Kerala ont alors décidé de retirer la licence de pompage à Coca-Cola, mais la décision n'a pas été suivie d'effets. En 2003, les femmes ont poursuivi leur lutte et ont organisé des sit-in autour des usines après que le gouvernement a déclaré les eaux de la région impropres à la consommation. Ces mouvements citoyens ont perduré. Des dizaines d'autres chaînes humaines se sont formées autour des usines de Coca et Pepsi-Cola. En 2004, enfin, le gouvernement a fait fermer l'usine du Kerala et, en 2010, la société a été condamnée à payer une indemnisation au gouvernement. Pour le magistrat qui a fait passer la décision, l'eau est un bien public, elle ne peut être utilisée à des fins commerciales, et ce, même en l'absence d’une loi régissant l’utilisation des nappes phréatiques. Depuis lors, Coca-Cola tente d'améliorer sa gestion d'eau en Inde, en installant des citernes de récolte d'eau de pluie, en diminuant la consommation d'eau pour la production de ses boissons et en arrêtant de redistribuer aux paysans des boues contaminées.
Le cas argentin
Dans les années 90, des pressions internationales de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et des États-Unis, poussèrent le gouvernement argentin à privatiser ses entreprises publiques. La gestion de l'eau était, à ce moment, lamentable : les pertes en eau sur le réseau dues aux fuites flirtaient avec les 50 %, les coupures étaient fréquentes en été, le traitement des eaux usées laissait à désirer et 30 % de la population n'avait tout simplement pas accès au réseau de distribution. Dès que la privatisation fut annoncée, en 1993, le prix de l'eau augmenta. Cette hausse tarifaire permit au gouvernement de mieux faire accepter son plan de privatisation en faisant miroiter une diminution des prix et une amélioration du réseau de distribution. En 2003, une filiale de Suez, Aguas ArgentiArgentinas, remporta le marché. Et de fait, l'entreprise diminua le prix de l'eau et promit d'investir pour améliorer le réseau de distribution et la récupération de l'eau. Le modèle argentin était alors encensé par la Banque mondiale. L’idylle fut de courte durée. Six mois après la privatisation, Aguas Argentinas négocia avec le gouvernement une hausse des prix en arguant du fait que les coûts d'entretien et de réparation étaient plus importants que ceux convenus dans le contrat de base. La facture d'eau des consommateurs – qui ne virent, du reste, pas vraiment arriver les améliorations promises en termes de densification du réseau de distribution et de qualité de l’eau – augmenta de 42 % entre 93 et 2001. En 2005, face à la pression de la population, qui manifesta dans la rue contre la firme argentine, mais aussi à cause de la crise économique qui fit exploser la dette de l’entreprise privée(2), Suez a décidé de quitter le pays et de revendre sa filiale à deux fonds d'investissement. Depuis lors, Suez hésite fortement à investir dans des pays en voie de développement.
Possible en Belgique ?
Les entreprises désireuses de s'installer sur le sol belge sont contraintes de suivre les directives européennes en matière d'usage de l'eau et de pollution. La première directive, celle-là même qui relaie le principe du consommateur-payeur (2000/60/CE), définit également les conditions d'utilisation durable et raisonnée de la ressource, afin de garantir une eau de qualité pour le futur et de s'assurer que les réserves ne s'épuisent pas. La deuxième directive (2008/1/CE) traite de la pollution des nappes phréatiques, pollution issue notamment de l'exploitation industrielle. Par ailleurs, nos mandataires publics siégeant aux conseils d'administration des intercommunales ont des comptes à rendre à leurs électeurs, et les entreprises privées doivent consulter les intercommunales et obtenir l'accord de la Région avant de puiser le moindre litre d'eau. Il est donc peu probable, par exemple, que le rachat de Chaudfontaine par Coca-Cola en Belgique conduise à des dérives telles que celles observées en Inde. La question est plus délicate en ce qui concerne la privatisation de la gestion. Si la production et la distribution de l'eau sont entièrement aux mains des autorités publiques en Belgique, il n'en va pas de même au niveau de l'épuration. Bruxelles a déjà fait les frais de cette délégation au privé en 2010.
* Cet article est basé sur une analyse d'Antoine Fain, Quand la soif industrielle déshydrate les populations, mars 2012, Réseau Financement Alternatif. Disponible sur www.financite.be, rubrique bibliothèque.
1. « Les femmes du Kerala contre Coca-Cola », dans Le Monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr/2005/03/SHIVA /11985.
2. La crise économique qu'a connue l'Argentine entre 1998 et 2002 a entraîné la rupture de la parité pesos/dollars. Ceci a eu pour conséquence de faire exploser la dette d'Aquas Argentinas en dollars.
En Inde, Coca-Cola est accusé d'assécher les nappes phréatiques. En Argentine, une société privée gère la distribution de l'eau. Dans les deux cas, le gouvernement s'en mord les doigts tandis que la société civile paie les pots cassés.