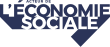Investir dans l'économie sociale
Rapport de la conférence organisée les 22 et 23 mai 1995 à Birmingham par L'Association internationale des investisseurs dans l'économie sociale et le UK social investment forum.
Une finance garante du travail décent
Comme le montrent les exemples des Fonds norvégien et de Portfolio 21, les investisseurs peuvent refuser de rester bras croisés devant le financement d’entreprises qui violent ou contribuent à la violation des droits sociaux
les plus élémentaires. Chaque épargnant peut s’enquérir de la politique de sa banque à cet égard. Mais, bien sûr, il n’a pas les moyens de vérifier si les boniments qu’on lui sert correspondent bien à la réalité, y compris pour des produits étiquetés « éthiques »... Alors ? Une proposition est actuellement sur la table, celle de créer une norme légale minimale pour qu’un produit financier puisse se proclamer « éthique », socialement responsable » ou « durable » C’est cette logique qui a prévalu en matière d’armements controversés : la loi belge interdit à présent de financer les entreprises impliquées dans les mines antipersonnel, les sousmunitions ou les armes à uranium. Pourquoi ne pas utiliser la même logique en ce qui concerne les normes de l’Organisation internationale du travail en matière de travail décent ? Cette norme interdirait le financement d’entreprises ou États à propos desquels il existe des indices sérieux et concordants qu’ils se rendent coupables comme auteurs, co-auteurs ou complices, ou qu’ils tirent avantage d’actes prohibés par les conventions internationales ratifiées par la Belgique, dans les domaines suivants :
• droit humanitaire (réglementations en matière d’armement, de guerre...) ;
• droits sociaux (liberté syndicale, travail des enfants, travail forcé... On se réfère ici aux conventions de l'O.I.T. (cf. dossier Finançons le travail décent);
• droits civils ;
• environnement ;
• gestion durable.
Les promoteurs d’investissements socialement responsables pourraient compléter la sélection négative, basée sur des « listes noires » d’entreprises à éviter, par des critères de sélection positive. Ils seraient alors tenus de pratiquer une analyse extrafinancière des impacts sociaux et environnementaux des entreprises et des États, et d’en rendre compte avec transparence à leurs clients. Ils seraient aussi obligés de faire certifier leurs produits financiers par un organisme externe et indépendant (1).
Au-delà de la norme ISR, on pourrait argumenter que tous les investisseurs devraient respecter les conventions ratifiées par la Belgique.
(1) Cf. « Définition d’une norme légale d’investissement socialement responsable », dans Cahier FINANcité, nº 12, décembre 2008, disponible en format papier ou en ligne sur www.financite.be
Le Fonds norvégien du pétrole
Le Fonds norvégien du pétrole rassemble par transferts budgétaires une partie des revenus tirés de l’exploitation et des ressources pétrolières norvégiennes. Ce fonds est l’un des plus gros fonds de pension du monde. Depuis 2004, il est géré en vue d’un rendement responsable, pour éviter de contribuer, par ses investissements, à des violations de droits humains ou de principes éthiques fondamentaux :
• les pires formes de travail des enfants et d’autres formes d’exploitation des enfants ;
• les atteintes graves aux droits individuels dans des situations de guerre ou de conflit ;
• la dégradation sévère de l’environnement ;
• la corruption massive ;
• d’autres violations particulièrement sérieuses des normes éthiques fondamentales.
À ce jour, 29 sociétés ont été exclues du fond, parmi lesquelles EADS, Thalès, BAE systems, Boeing Co., Vedanta Ressources, Rio Tinto, et Wal-Mart. Wal-Mart (cf. article) a été exclue en 2006 sur base du constat suivant : « De nombreux documents indiquent que Wal-Mart, de manière globale et systématique, emploie des mineurs en violation des règles internationales, que les conditions de travail chez plusieurs de ses fournisseurs sont dangereuses, que des ouvriers sont fortement incités à effectuer des heures supplémentaires sans compensation, que la compagnie pratique la discrimination salariale à l’encontre des femmes, que toutes les tentatives des employés pour se syndiquer sont stoppées, que les employés sont, dans un certain nombre de cas, déraisonnablement sanctionnés et enfermés [de force sur leur lieu de travail, ndlr]. » Ceci concerne non seulement les opérations commerciales de Wal-Mart aux Etats-Unis et au Canada, mais aussi celles de ses fournisseurs au Nicaragua, au Salvador, au Honduras, au Lesotho, au Kenya, en Ouganda, en Namibie, au Malawi, au Madagascar, au Swaziland, au Bangladesh, en Chine et en Indonésie.
Portfolio 21
L’ensemble du portefeuille d’investissement de Dexia Insurance Belgium répond aux normes Portfolio 21 : un
bureau de recherche indépendant spécialisé passe au crible le respect des droits humains sur les lieux de travail,
tels que définis par les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail, par les émetteurs d´actions et d´obligations repris dans les portefeuilles de placement. Un processus de dialogue est ensuite entamé avec les émetteurs qui sont supposés ne pas respecter ces normes internationales du travail afin d´obtenir des informations supplémentaires et, le cas échéant, d´améliorer leurs pratiques en matière de droits des travailleurs. A noter toutefois que Dexia ne définit nulle part de manière claire quel type d’investissements elle juge inacceptable et ne fournit aucune explication sur les investissements qui ont été faits et ceux qui ont été refusés.
Les investisseurs peuvent agir... Davantage de règles leur faciliteraient la tâche ! En bref : Deux exemples : le Fonds norvégien du pétrole et Portfolio 21. Une norme légale d'investissement socialement responsable est à l'agenda du gouvernement belge.
Le capital des travailleurs, levier daction
Autre réalité, autre logique syndicale
En matière de pensions, la priorité des syndicats est de défendre le « premier pilier » (cf. encadré) géré par l’État. D’un pays à l’autre, la situation diffère, mais, en tout état de cause, les syndicats belges et français sont peu enclins à se mêler du fonctionnement des fonds de pension, considérant comme un piège leur implication dans un système privatisé, fût-ce pour l’améliorer. Les détracteurs des fonds de pension soulignent ce point commun entre
la répartition des cotisations (1er pilier) et la capitalisation (2e et 3e piliers) : comme les retraites, les rentes sont toujours prélevées, au cours d’une année, sur les richesses produites et disponibles au cours de cette même année. Les retraites privées sont donc aussi aléatoires que les retraites publiques ! Dans les pays anglo-saxons et en Amérique latine, les syndicats ont dû faire face, dès les années 80, à la privatisation des pensions orchestrée
par leurs gouvernements. Il s’agissait donc de défendre l’intérêt des travailleurs pour que les gestionnaires des fonds gérant leur future retraite prennent réellement en compte l’intérêt de ces millions d’actionnaires. L’établissement, en 1999, du Comité pour la coopération internationale en matière de capital des travailleurs (CWC) fut un premier pas vers la construction d’une « internationale » des travailleurs actionnaires. Un pas plus
décisif encore fut franchi en 2003, quand le Trade Union Congress anglais (communément appelé le TUC) publia « Working capital », véritable petit livre rouge de l’investissement socialement responsable à l’usage des trustees représentant les travailleurs et leurs organisations syndicales dans les conseils d’administration des fonds de pension.
La boîte à outils du parfait trustee
« Working capital » plaide pour l’intérêt du travailleur actionnaire investissant dans un fonds de pension comme pour l’intérêt du travailleur de l’entreprise financée par ledit fond. Ceci sur la base d’études démontrant que le travail décent améliore la productivité, et que l’intérêt à long terme des « propriétaires de l’argent » implique un « capital patient », investi dans des entreprises durables. Ce manuel préconise aussi de s’engager aux côtés des entreprises financées pour améliorer leur gouvernance et de réserver l’exclusion d’entreprises problématiques au dernier recours. Il propose une méthode de travail avec les gestionnaires de fonds, amenés à voter dans les assemblées générales des entreprises financées. Il s’agit donc de contrôler leur activité. Les trustees affiliés au TUC sont invités à s’allier avec d’autres actionnaires activistes pour faire voter des motions dans les assemblées générales des entreprises, à suivre des formations et à former un réseau.
L’internationale de l’argent pour demain
En 2009, ce réseau de trustees britanniques s’est pérennisé. Il collabore au niveau international avec le CWC. Le site www.workerscapital.org, décline lui aussi une véritable « boîte à outils », disponible notamment en français : activisme coordonné d’actionnaires, campagnes de votes par procuration, méthodes coordonnées pour venir à bout d’irrégularités persistantes au sein des transnationales, investissements ciblés en fonction de besoins prioritaires de l’activité économique.
Via les fonds de pension, les travailleurs sont aussi des actionnaires. A ce titre, ils peuvent agir aussi ! En bref : Petit à petit, à l'échelle globale, les syndicats ont développé une méthode pour orienter les fonds de pension vers des investissements socialement responsables.
Fonds actions Responsables et Durables IRD : Performances, risques et encours
Guide des organismes d'analyse sociétale
"Qui sont les organismes qui évaluent votre performance sociale, environnementale et éthique?
Quelles méthodes et quels critères utilisent-ils pour construire les fonds et indices "éthiques"?"
Screening and Rating Sustainability Guide
Current issues on corporate governance and sustainability of companies in the stock market are highly debated. How are companies screened and rated on sustainability issues? This guide provides backgroundd information, techniques and views from analysts who advise companies, financial institutions and investors about sustainability performances.
Finance islamique et ISR : convergence possible ?
Comment expliquer la performance de l'investissement socialement responsable ?
• Définitions et performance de l'investissement socialement responsable — Typologie des fonds ISR — Analyse de la performance • Les origines de la performance de l'ISR — La vertu au service de la performance — La méthodologie en questions • Conclusion • Bibliographie
Engagement ou exclusion : quelle est la méthode la plus efficace pour un gestionnaire d'actifs institutionnels ?
Introduction
Dans les faits, un gestionnaire d'actifs institutionnels peut être, entre autres, une société de gestion, une compagnie d'assurance, une caisse de retraite ou un fonds commun de placement. En tout état de cause, son but est d'investir les capitaux qui lui sont confiés dans des actions. Fort de cette mission, il peut influencer la manière dont est utilisé cet argent. C'est ainsi qu'historiquement ce sont des fonds publics, syndicaux ou religieux qui ont voulu orienter les politiques de gestion des entreprises dans lesquelles ils investissaient vers une meilleure prise en compte des facteurs sociaux, environnementaux ou de bonne gouvernance1.
De nos jours – et dans une plus forte mesure encore depuis la crise financière –, les gestionnaires d'actifs institutionnels mettent en place des garde-fous pour assurer une certaine cohérence dans leurs placements. Ainsi, pour augmenter la prise de conscience des critères extrafinanciers, ces différentes organisations appliquent diverses démarches dont celles dites « d'engagement »2 et « d'exclusion »3.
Examinons tout d'abord, ce que signifient ces termes dans le domaine de l'ISR. L'engagement, selon le glossaire de Novethic, média français expert du développement durable et de l’investissement socialement responsable,« est un terme, utilisé surtout dans les pays anglo-saxons, pour désigner une activité de dialogue entre un actionnaire institutionnel (fonds de pension, sociétés de gestion, etc.) et une entreprise dont le but est d'améliorer sa performance financière, à moyen et long terme, en facilitant une meilleure prise en compte des facteurs de risques environnementaux et sociétaux. Quand ce dialogue ne donne aucun résultat, l'investisseur-actionnaire porte le débat sur la place publique, lors des assemblées générales. »4 C’est une sorte d'activisme actionnarial, où le dialogue reste tant que possible dans l'arène privée des entreprises. Il s’agit dès lors d'une méthode dynamique et progressive pour entraîner les entreprises à considérer des aspects environnementaux, sociaux et de transparence.
L'exclusion, ou « screening négatif », ou encore « tamisage négatif », est quant à elle une technique plus brusque. L'auteur de l'article Évolution sémantique de l’investissement socialement responsable5, définit ce concept comme visant « à exclure de son univers d'investissement des entreprises impliquées dans certains secteurs d'activités ou produits et services. [...] L'exclusion sera soit globale – exclusion de l’ensemble du secteur d'activité ou exclusion géographique – soit nuancée, par exemple, exclusion des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires proviennent de la vente d'armes. » Dès lors, la manière dont cette exclusion se fait est plutôt directe et elle peut être perçue comme agressive. Les exemples qui suivent illustrent les avantages et les inconvénients respectifs de ces pratiques.
Deux exemples : F&C Investments en Grande-Bretagne et Kommunal Landspensjonskasse (KLP) en Norvège
Le premier exemple concerne la société de placement F&C Investments. Avec 3 millions de clients, 120 milliards d'euros d'actifs et une présence dans une cinquantaine de pays sur trois continents, cette compagnie de taille relativement importante applique une méthode qu'elle a baptisée Reo ("Responsible Engagement Overlay") qui consiste en trois grandes actions :
- utiliser les actions de leurs clients comme levier pour encourager les entreprises à améliorer leur performance à long terme à travers une meilleure gestion des risques environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance ;
- exercer cette influence à travers l'engagement et le vote ;
- mettre en œuvre les PRI6.
Plus concrètement, l'équipe de Karina Litvack, directrice de la Gouvernance et des Investissements durables, s'attache à faire évoluer les choses de l'intérieur par la technique de l'engagement7. Cette technique se déroule en plusieurs temps. Autant de rendez-vous de dialogue avec l'entreprise ou le secteur concerné que nécessaire sont mis en place pour orienter les décisions des présidents d’entreprises vers un comportement plus respectueux du développement durable.
Le secteur bancaire en Grande-Bretagne fournit depuis plusieurs années un bon exemple de cette pratique. Le gestionnaire F&C Investments interpelle les grandes banques anglaises sur une série de sujets, dont la bonne gouvernance, la tension salariale ou le changement climatique. Une des clefs de la réussite de cette méthode est la fréquence des réunions de dialogue, la participation active à des formations internes des banques ainsi que des sessions de consultation et de feedback avec les décideurs.
Plus particulièrement, la Banque HSBC s’est vu demander des comptes en termes de gestion prudente des risques sur les opérations subprimes aux États-Unis. À la suite de cette démarche d’engagement, la banque a détaillé une série de mesures afin de gérer au mieux ces opérations. F&C Investments continue à exprimer ses craintes à ce sujet et à évaluer les progrès faits en la matière.
La stratégie de dialogue employée par F&C Investments dans ce cas est donc de longue haleine, mais semble apporter une amélioration aux pratiques de la banque en question.
Un deuxième exemple décrit la méthode utilisée par KLP. Malgré son statut « d’une des plus grandes compagnies d'assurance-vie en Norvège », cette entreprise est relativement petite avec ses 442 000 clients et ses 23,12 milliards d’euros d’actifs. Sa manière de gérer les fonds est toutefois très intéressante.
Jeanett Bergan, directrice de l’Investissement socialement responsable, explique la manière de procéder de KLP : « Nous utilisons une stratégie en deux parties : nous utilisons la synergie des méthodes d’engagement et d’exclusion »8. En effet, KLP pratique, d’un côté, l’exclusion selon des critères stricts sur les droits humains, le droit du travail, la protection de l’environnement, l’anti-corruption et les armes9 et, de l’autre, l’engagement afin de faire connaître aux entreprises les démarches à mettre en place ou à rectifier pour faire partie de leur univers d’investissement.
Si certaines entreprises sont exclues d'office du fait de la nature de leurs activités10, comme les entreprises de tabac par exemple, d’autres risquent l’exclusion si elles ne changent pas leur comportement à la suite d’un avertissement du Global Ethic Service (GES), département de KLP analysant les compagnies de manière régulière. Un élément important de la stratégie de KLP : elle publie deux fois par an la liste des entreprises qu’elle exclut de son univers d’investissement et les raisons de cette exclusion.
Un exemple concret est le cas de l’entreprise de services de restauration et de chèques services Sodexho. KLP a d’abord dialogué avec Sodexho pour dénoncer les conditions inhumaines de l’« Immigration Removal Centre — IRC »11 de Harmondsworth en Angleterre géré par Kalyx, une filiale de Sodexho12. Vu les faits de violation des droits humains, elle décide d’exclure Sodexho de son univers d’investissement en 2007 et publie un communiqué de presse sur cette exclusion13. Cette action publique mène Sodexho à régler rapidement la situation à l’IRC et à développer une politique d’entreprise globale sur les droits humains. En décembre 2008, Sodexho réintègre l’univers d’investissement de KLP.
La stratégie de KLP consiste donc en un mélange de dialogue et d’action publique d’exclusion, qui a permis des améliorations concrètes dans le cas décrit.
Conclusions
À travers les deux exemples cités, nous observons que chaque méthode présente des avantages et des inconvénients pour le gestionnaire d'actifs institutionnels. Le tableau ci-dessous en recense les principaux :
|
|
Avantages de la démarche |
Inconvénients de la démarche |
|
engagement |
- progressive, dynamique et évolutive - possibilité de réel changement corporatif - identification des risques à la source - maintien de bonnes relations entreprises-actionnaires |
- chronophage - relativement coûteuse |
|
exclusion |
- impact de levier du public - telle que pratiquée par KLP, non définitive - obtention possible de résultats rapides |
- peut couper court à une relation actionnaire-entreprise |
Ce tableau permet d’observer qu’aucune des deux méthodes n’est radicalement « meilleure » que l’autre. Il montre également que ces techniques peuvent se compléter et faire partie d’une même stratégie pour tendre vers une meilleure prise en compte des facteurs de risques environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. KLP semble bien tabler sur la complémentarité pour arriver à faire changer le comportement d’importantes multinationales. F&C Investments, quant à elle, cherche plutôt un changement à long terme à coups de rendez-vous et de votes.
En conclusion, les deux méthodes sont valables et une utilisation « synergique » des deux est probablement la voie la plus ferme et la plus efficace pour orienter les entreprises vers un univers d’investissement socialement responsable.
Annika Cayrol
mars 2009
1 Lire les articles L'actionnaire public au balcon ? et Les syndicats et l'investissement responsable de Bernard Bayot, disponibles sur www.financite.be
2 D'origine anglo-saxonne, le terme "engagement" est parfois traduit par l'expression "accompagnement" en français.
3 L’exclusion est une partie de la technique de screening, celle-ci pouvant être négative (exclusion) ou positive (best-in-class). Cet article se limite volontairement à comparer deux pratiques – « engagement » et « exclusion » – qui, à elles deux, ne représentent pas l'ensemble des techniques utilisées.
5 Demoustiez, Alexandra, Évolution sémantique de l’ISR, disponible en ligne : http://www.financite.be/publications/mes-articles/evolution-semantique-de-l-isr-investissement-socialement-responsable,fr,372.html
6 UNPrinciples for Responsible Investment, pour plus d'informations voir : http://www.unpri.org/principles/french.php
7 Conférence Novethic, « Environnement, Social et Gouvernance : nouvelle donne pour les investisseurs institutionnels », 5 décembre 2008
8 Conférence Novethic, « Environnement, Social et Gouvernance : nouvelle donne pour les investisseurs institutionnels », 5 décembre 2008
9 Ces critères proviennent de guidelines tels que les dix principes de l’UN Global Compact, les lignes directrices de l’OCDE sur les multinationales et certaines normes de l’UN.
10 Les entreprises exclues du Fonds de pension du gouvernement norvégien sont automatiquement exclues de leur univers d’investissement.
11 Sorte de lieu de détention où les immigrants sont en attente de rapatriement dans leur pays d’origine, plus d’informations sur : http://www.kalyxservices.com/locations/harmondsworth_irc.aspx
12 Plus d’informations sur : www.klp.no/web/klpmm.nsf/lupgraphics/KLP_list_december_2007.pdf/$file/KLP_list_december_2007.pdf
De plus en plus de gestionnaires d'actifs institutionnels placent leurs avoirs dans l'investissement socialement responsable (ISR). Ils décident de leur univers d'investissement et peuvent influencer les entreprises ou les États qui les composent par divers stratagèmes. Cet article s'attache à comparer les méthodes dites, d'une part, « d'engagement » et, d'autre part, « d'exclusion », à travers deux exemples en Europe.
Pagination
- Page précédente
- Page 61
- Page suivante