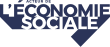La loi du 20 mars 2007, interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions
Une altérité bancaire solidaire en Europe : Mythe ou Réalité ?
Enfants au travail : retour au XIX e siècle ?
Convention 182 : le socle
La convention visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants a été ratifiées par 132 pays en moins de 3 ans : un record ! En janvier 2008, 165 pays l’ont ralliée. Cependant, il n’est pas rare de découvrir des enfants exploités tels des esclaves, par des sous-traitants de multinationales cotées en Bourse.
La convention 182 est pourtant explicite : « Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence (article 1) ». Elle reconnaît dans ses considérants que « le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté » et que par mesure efficace il faut entendre « une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base gratuite ».
On le sait sans le savoir
Le 29 octobre 2007, à New Delhi, le Bachpan Bachao Andolan (Mouvement « Sauvez l’enfance ») surprend, avec l’aide de la police, un sous-traitant de l’entreprise GAP en flagrant délit d’exploitation infantile. Bhuwan Ribhu, avocat, militant pour la Global March Against Child Labour, pointe alors du doigt les commanditaires occidentaux : « La réalité, c’est que la plupart des majors de la confection textile jouent le même jeu, réduisant les coûts sans prendre en considération les conséquences d’une telle politique ».
Dès l’annonce de cette sinistre découverte, Market Watch. (1), filiale de l’Index Down Jones, publie un communiqué informant les investisseurs. Qu’ils se rassurent : les managers de GAP, horrifiés, ont déjà dénoncé leur soustraitant et déclenché un plan catastrophe. Les enfants sont confiés aux autorités locales, leur scolarisation sera financée par le contrevenant et les produits sortant de cet atelier sont retirés de la vente.
Ainsi, quand les gestionnaires de fonds de placement découvrent le problème, la multinationale mise sur la sellette invoque le cas accidentel du sous-traitant non autorisé qui n’a pas respecté son code de conduite. Pendant ce temps, investisseurs et multinationales continuent de mettre l’économie mondiale sous pression en faisant dégringoler les minima sociaux avec des exigences de rentabilité toujours plus grandes...
Pour empêcher tout risque de dérapage, les investissements ne doivent-ils pas être soumis à des clauses de respect de normes sociales permettant un travail décent et une vie décente, pour les adultes comme pour les enfants ? Certes, le manque d’éducation permet aussi que se perpétue l’exploitation de
main d’oeuvre infantile, privée d’école. C’est le cercle vicieux. Il n’en reste pas moins important de relever les minima sociaux. C’est bien l’optique de la convention 182 : « une action d’ensemble immédiate », incluant l’accès à l’éducation gratuit.
Travail décent, vie décente
Outre le fait de combattre les clichés et d’éviter une approche trop radicale, et dès lors, simpliste, la Global March against Child Labour a le mérite d’offrir à tous, via son site, des outils d’argumentation et les clés d’une approche pédagogique, quel que soit le public interpellé (3).
Aussi, les organisations qui en font partie sont-elles actives par ailleurs pour promouvoir les standards sociaux de façon plus globale, selon la philosophie de l’action d’ensemble prônée par la convention 182. Celle-ci fait d’ailleurs partie du socle de normes fondamentales de l’OIT., qui deux jours après l’adoption de cette convention, le 19 juin 1998, adoptait une « déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi ». Celle-ci, plus large, garantit aussi la liberté d’association et de négociation collective, l’élimination du travail forcé et la lutte contre les discriminations à l’emploi.
Selon cette déclaration, le fait même d’être membre de l’OIT engage les États quand bien même ceux-ci n’auraient pas ratifié chacune des conventions de base. L’OIT consacrait ainsi le principe d’une approche globale des standards sociaux, ces normes fondamentales étant reprises depuis lors dans nombre de codes de conduites d’entreprises et autres textes de référence.
Dix ans plus tard, alors que la globalisation a accru la pression sur les normes sociales, les réseaux internationaux de syndicats et d’ONG entendent remettre en tête des priorités des plus élémentaires. Ils mèneront, en 2008 et en 2009, une campagne d’opinion sur le thème « Travail décent, vie décente », coordonnée en Belgique francophone par le CNCD (4).
La régulation des acteurs privés fait partie des revendications avancées par la coalition « travail décent » : ceux-ci souhaitent que les politiques commerciales et d’investissement soient subordonnées au respect de normes sociales et que les multinationales et leurs filiales soient tenues de respecter ces normes.
Ils appellent aussi à la régulation du système financier international afin que celui-ci impulse des politiques créatrices d’emplois décents. Puisse la crise boursière de ce début d’année 2008 convaincre les gouvernants d’accéder rapidement à ces revendications !
Antoinette Brouyaux
(2) Point de contact de la Global March en Belgique : Solidarité Mondiale, chée de Haecht 579, 1030 – Bruxelles www.solmond.be
(4) CNCD, rue du Commerce 9, 1000 Bruxelles www.decentwork.org
C’est à votre oreille que votre GSM cause le moins de dégâts!En mai 2007, Test-Achats dressait ce terrible constat : «rares sont les standards sociaux qui se frayent un chemin jusqu’aux usines». Dans la production de GSM, l’écrasante majorité des salaires ne permettent pas de vivre décemment. Pas une usine chinoise ne respecte les barèmes en vigueur. Heures supplémentaires forcées, sous-payées et excessives, enfants au travail... « Tant qu’ils n’ont pas l’air trop jeunes, cela ne pose aucun problème », confie le manager d’une usine de Shenzhen aux enquêteurs de Test-Achats, éberlués d’y découvrir plus de 200 enfants de moins de 16 ans. Ces jeunes sous-payés sont amenés à l’usine par leurs professeurs pour rembourser leurs frais d’étude... Et produire des chargeurs pour Motorola. Les enquêteurs dénoncent que les fabricants ne dévoilent aucun résultat d’audit vérifiant sur les sites de production le respect de leurs excellents codes de conduite, et que les contrôles sont le plus souvent menés par les fournisseurs eux-mêmes sans vérification externe. Les compagnies ne réagissent généralement qu’au cas par cas. Lorsqu’elles se voient reprocher un manquement ici ou là, elles rectifient le tir localement sans changer les règles du jeu partout. |
17 juin 1999, Genève, Organisation internationale du travail (OIT). La convention 182 sur les pires formes de travail des enfants est unanimement adoptée. Il était temps, à la veille du 3e millénaire ! Depuis, les scandales se suivent. Que font les investisseurs pour les éviter ?
Le profit avant les vies humaines ?
Historique
En mars 2001, un procès à Pretoria opposait l’Association sud-africaine des fabricants de médicaments à l’État sud-africain. En cause : une loi de 1997 favorisant les médicaments génériques, moins chers que les produits de marque, pour permettre l’accès aux soins au plus grand nombre possible de personnes atteintes du SIDA. Ce pays était alors le plus touché au monde par la pandémie : 10 % de sa population.
Face à cette évidence et grâce au soutien de la société civile internationale, les compagnies pharmaceutiques sont mises en déroute et le débat rebondit à l’OMC. Le 14 novembre 2001, à Doha, l’OMC accouche d’un compromis – la déclaration de Doha – qui reconnaît aussi bien l’importance des brevets pour l’industrie pharmaceutique que l’urgence pour les gouvernants des pays pauvres de prendre des mesures de santé publique, pour permettre l’accès aux traitements des malades du SIDA, de la tuberculose, du paludisme ou d’autres épidémies.
Sept ans après la déclaration de Doha, les entreprises du secteur rechignent toujours à respecter l’esprit de cet accord. Et Médecins Sans Frontières, Oxfam ou même la Fondation Clinton de voler au secours des malades. Quid des investisseurs ?
L’activisme actionnarial a aussi une histoire
En 1982, l’Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), une coalition de 275 investisseurs institutionnels religieux, organise une campagne en direction des firmes pharmaceutiques.
Cette année-là, le gouvernement du Bangladesh édicte une loi interdisant 1 700 médicaments considérés comme dangereux ou inutiles et publie une liste de 150 médicaments essentiels pour les soins et de 100 médicaments de base dans les hôpitaux. Les multinationales du secteur pharmaceutique menacent de se retirer du pays et recherchent l’appui du gouvernement américain. Les congrégations religieuses se mobilisent alors pour soutenir le droit d’un pays du Sud à définir sa politique sanitaire. Elles interpellent les groupes pharmaceutiques qui finalement maintiennent leur implantation au Bangladesh et se rallient au principe des « listes de médicaments essentiels ».
En 2003, dans la foulée de la campagne internationale de sensibilisation orchestrée par Oxfam sous le slogan « Cut the Cost » à l’encontre de la multinationale anglo-américaine GlaxoSmithKline (GSK), c’est CalPERS, premier fonds de pension américain, qui embraye. Le 15 avril 2003, cette caisse de retraite l’État de Californie demande à GSK, dont il est un actionnaire à hauteur de 0,66 % environ, de faciliter l’accès à des versions génériques de ses médicaments anti-SIDA. Dans un texte voté
à l’unanimité par son comité d’investissement, le fonds de pension s’inquiète du « comportement d’entreprise » de GSK et mentionne que son attitude face au SIDA pourrait entacher la réputation du groupe et nuire à la valeur de l’action. Le 28 avril 2003, GSK annonce une baisse du prix des médicaments anti-SIDA dans les pays pauvres (1).
En 2004, l’ICCR reprend le relais. R éagissant à la menace que la pandémie fait planer sur la vie de milliers d’individus, sur l’économie des pays touchés et sur la valeur des actions des entreprises qui ont des activités dans ces pays, l’ICCR demande notamment aux sociétés pharmaceutiques de produire un rapport décrivant les effets du SIDA sur leurs activités, ainsi que les mesures prises pour y faire face.
But de l’ICCR : améliorer in fine l’accès aux traitements, dans différents pays pauvres où les enfants sont affectés en grand nombre (1).
Les donateurs s’en mêlent
On trouve ainsi divers exemples d’initiatives prises par des fonds de placement ou autres investisseurs. Ceux-ci sont en général plus discrets que Médecins Sans Frontières, Oxfam ou que des personnalités telles que Bill et Melinda Gates – dont la fondation s’attaque au paludisme – ou Bill Clinton. La Fondation Clinton est active dans la lutte contre le SIDA depuis plusieurs années et négocie avec les fabricants de médicaments des compromis permettant à des États d’Afrique et d’Amérique latine d’offrir à leurs malades un accès aux soins à des prix proportionnels à leur niveau de vie. En mai 2007, elle a conclu avec deux fabricants de médicaments génériques indiens, Cipla et Matrix, un accord pour réduire le coût des antirétroviraux de dernière génération. 40 millions de personnes infectées par le virus du SIDA dans 66 pays à bas et moyens revenus y auront ainsi accès. Mais Bill Clinton reste avant tout un homme politique, aux côtés de son épouse candidate...
Pendant ce temps, les compagnies pharmaceutiques continuent de chercher noise aux États tels que l’Afrique du Sud, la Thaïlande, l’Inde ou le Brésil qui tentent de faire respecter l’accord de Doha.
Brevets v/s génériques : que de conflits!
Le cas de l’Efavirenz de Merck
Afrique du Sud : 10 ans après le fameux procès de Pretoria, le 7 novembre 2007, Treatment Action Campaign (TAC) porte plainte auprès de la Commission de la concurrence contre les pratiques monopolistiques de la plus grande entreprise pharmaceutique mondiale, Merck, et de sa filiale sud-africaine, MSD (2). Ces entreprises empêchent la commercialisation de l’antirétroviral Efavirenz dans des conditions supportables pour le budget de l’État...
Le cas du Kaletra de Abbott
Sommées d’adapter leurs prix, les entreprises pharmaceutiques ne cèdent qu’en fonction de la visibilité du pays ou de la maladie en question. Ainsi, les laboratoires Abbott vendaient l’antirétroviral Kaletra à 2 200 dollars par patient et par an dans les pays à faibles et moyens revenus tels que le Guatemala, où le salaire annuel moyen est de 2 400 dollars. Ce n’est que lorsque la Thaïlande a décidé d’appliquer une licence obligatoire pour faire diminuer le prix du Kaletra à 1 000 dollars, que le laboratoire Abbott en a réduit le prix à 1 000 dollars par patient et par an à l’échelle mondiale.
Ensuite, en mars 2007, Abbott a pris des mesures de rétorsion contre la Thaïlande en refusant d’y commercialiser la nouvelle version du Kaletra. Celle-ci, ne devant pas être réfrigérée, est pourtant en vente depuis 2005 aux États-Unis (3).
Le cas du TDF de Gilead Science
Le 23 janvier 2008, l’Office américain des brevets refuse d’accorder un brevet à l’entreprise Gilead Science pour la production du tenofovir disoproxil fumarate (TDF). Ceci grâce à la pression d’une fondation d’utilité publique, la Public Patent Foundation (PUBPAT), qui a pu démontrer que le TDF était déjà connu au moment où Gilead a introduit sa demande de brevet.
Cette décision pourrait faire basculer celles d’instances octroyant des brevets dans d’autres pays comme l’Inde – où le brevet a déjà été accordé – ou le Brésil, où le débat n’est pas clos.
Et ainsi ouvrir la voie à la production... puis à l’exportation de versions génériques moins chères (4). Une victoire qui rend espoir aux groupements de patients indiens et brésiliens, sur la brèche depuis de nombreuses années.
Antoinette Brouyaux
(1) Voir les articles sur l’activisme actionnarial sur le site www.financite.be», rubrique « M a documentation »
(2) www.tac.org.za
(3) H. Vines-Fiestas, « I nvesting for life », 27/11/2007 www.oxfam.org
(4) Communiqué de MS F, 15/3/2007
Investing for life : business as usual ?Le rapport «Investing for Life» (3) d’Oxfam International présente les pratiques économiques des 12 plus grandes entreprises pharmaceutiques : Abbott, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventis and Wyeth. Selon l’auteur, Helena Vines-Fiestas, l’industrie pharmaceutique met en péril son propre avenir en empêchant des millions de personnes pauvres d’avoir accès aux médicaments. Les investisseurs eux-mêmes ne s’y trompent pas. A l’heure où 15 % des populations riches consomment plus de 90 % des produits pharmaceutiques, ils savent que les marchés émergents sont stratégiques et constatent que ces entreprises ont répondu à ce nouveau défi de façon incohérente. Elles ne sont pas parvenues à mettre en place une politique systématique et transparente de fixation progressive des prix, tenant compte du pouvoir d’achat des populations concernées. Inflexibles en matière de protection de la propriété intellectuelle, elles continuent de traîner les pays pauvres devant les tribunaux pour les empêcher d’avoir recours aux clauses de sauvegarde relatives à la santé publique. Pendant ce temps, elles favorisent les donations qui permettent de fournir des médicaments abordables aux populations, mais ce système n’est pas pérenne et s’avère parfois contre-productif. Dans ce contexte, relève l’auteur, la perte de confiance des investisseurs aurait déjà coûté mille milliards de dollars aux actionnaires de l’industrie pharmaceutique... |
Régulièrement, humanitaires et associations de patients reprochent aux compagnies pharmaceutiques de pratiquer des prix impayables pour les malades des pays pauvres, atteints du SIDA ou d'autres pathologies nécessitant des soins à vie. Investisseurs, vous aussi pouvez faire entendre raison aux majors du médicament !
Quels enjeux pour les fonds monétaires ISR ?
I. Marché monétaire français ...........................................3 Introduction................................................. 3 Cadrage : marché monétaire, pour quoi faire et comment ... 3 Taille et évolution récente....................... 4 Un retour aux fonds monétaires réguliers... ..................... 4 ... appelant l'ISR .......5 Marché monétaire ISR .................................................. 7 Un segment de marché en forte croissance ..................... 7 Fluctuations .............................................................7 Évaluation extra-financière des émetteurs de dette de court terme .. 8 Sélection ESG des émetteurs...................... 9 Un certain niveau de tolérance .................................10 Un degré de transparence variable.............................10 Une spécificité française ?.............................................10 Conclusion ...................................12 Annexe : Panel de l'étude............13
Un cadre juridique cohérent pour les investissements
L'exemple norvégien
Une source d'inspiration pourrait être à cet égard la Norvège. Celle-ci a créé en 1990 le Norwegian Government Petroleum Fund, qui rassemble une partie des revenus tirés de l’exploitation et de l’exportation des ressources pétrolières norvégiennes. En novembre 2003, le gouvernement norvégien a défini, pour ce fonds, des directives éthiques en matière d’investissement, fondées sur les critères d’exclusion suivants :
- les pires formes de travail des enfants et d’autres formes d’exploitation des enfants ;
- les atteintes graves aux droits individuels dans des situations de guerre ou de conflit ;
- la dégradation sévère de l’environnement ;
- la corruption massive ;
- d’autres violations particulièrement sérieuses des normes éthiques fondamentales.1
En Belgique aussi, une loi-cadre pourrait interdire les pires formes de bénéfices s’opérant au détriment d’autrui ou de la nature, et fixer, sur la base de critères sociaux et environnementaux, des objectifs et des limites aux gains autorisés. Le respect des accords internationaux signés par les autorités, qui expriment un consensus de la société belge, peut constituer le point de départ pour l’élaboration de cette loi-cadre.
Celle-ci pourrait guider les investissements publics, mais aussi privés. Cette approche a d'ailleurs déjà été adoptée puisque la Belgique a fait oeuvre de pionnier en interdisant le financement des entreprises dont l'activité consiste en la fabrication, l'utilisation, la réparation, l'exposition en vente, la vente, la distribution, l'importation ou l'exportation, l'entreposage ou le transport de mines antipersonnel et/ou de sous-munitions (loi du 20 mars 2007 interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions).
Est-ce que les pires violations des droits de l'homme, les atteintes aux droits sociaux fondamentaux, les dégradations intolérables de l'environnement ne justifient pas, elles aussi, une stricte interdiction de financer les entreprises et les États qui s'en rendent coupables ?
Qui va s'occuper de la « black list »?
Adopter une loi-cadre qui interdise les pires formes de bénéfices s’opérant au détriment d’autrui ou de la nature, c'est bien. Encore faut-il ensuite déterminer avec précision quels sont les entreprises et les États qu'il est interdit de financer au motif qu'ils violent les normes fondamentales qui auront été retenues en matière de droits de l'homme, de droits sociaux fondamentaux ou de dégradations intolérables de l'environnement. La question se pose déjà aujourd'hui.
Le 20 mars 2007, notre pays adoptait une loi interdisant le financement de la fabrication, de l'utilisation ou de la détention de mines antipersonnel et de sous-munitions. L’article deux de cette loi prévoit qu’« à cette fin, le Roi publiera, au plus tard le premier jour du treizième mois suivant le mois de la publication de la loi, une liste publique » des entreprises concernées. Comme cette loi est entrée en vigueur le 26 avril 2007, la liste en question doit être publiée au plus tard le 1er mai 2008.
En janvier 2008, répondant à une question parlementaire du sénateur Philippe Mahoux, le ministre des Finances, Didier Reynders, a précisé son intention à ce propos : il entend publier uniquement les noms des entreprises condamnées par un tribunal sur la base des dispositions de la loi du 20 mars 2007.
Cette interprétation est, pour le moins, restrictive : la loi ne prévoit pas, en effet, de n'inscrire dans la liste noire que les seules entreprises condamnées. Pire, elle revient à vider la loi de sa substance : les entreprises qui fabriquent des mines antipersonnel ou des bombes à sous-munitions ou celles qui soutiennent leurs activités ou traitent avec elles sont précisément basées à l'étranger, en particulier dans des pays qui ne connaissent pas de législation interdisant ce type d'activités.
Comment, dès lors, procéder pour établir cette liste noire ?
Proposition : un Conseil de l'investissement socialement responsable
Comme évoqué ci-dessus, le gouvernement norvégien a défini des directives éthiques fondées sur des critères d’exclusion en matière d'investissement. Il a ensuite institué un comité d'éthique au sein du Norwegian Government Petroleum Fund, chargé de mettre ces directives en oeuvre. Pour ce faire, le comité établit une liste d'entreprises qui répondent à ces critères d'exclusion et dans lesquelles le fonds ne peut dès lors investir.
Pourquoi ne pas s'inspirer de ce modèle et créer en Belgique un « Conseil de l'investissement socialement responsable » ? Celui-ci serait chargé d'établir la liste des entreprises et des États qui violent les principes édictés dans la loi-cadre qui interdit les pires formes de bénéfices s’opérant au détriment d’autrui ou de la nature. La proposition de créer un tel conseil, chargé notamment de définir un standard minimum pour pouvoir qualifier un investissement d'éthique, avait été déposée par le sénateur Mahoux sous la précédente législature. Ce conseil pourrait se voir confier cette tâche supplémentaire.
Pour ce faire, il aurait égard aux rapports des agences de notation sociétale des entreprises et des États. Ces rapports font évidemment référence aux éventuelles condamnations encourues mais aussi à toute autre information fournie par les parties prenantes. Dans le cas d'une entreprise, il s'agit non seulement de la direction mais aussi des travailleurs et de leurs syndicats, des clients et de leurs associations, des ONG de droits humains et d'environnement ... Le conseil, sur la base de ces rapports et de toute autre information qu'il aura collectée, établirait alors une liste noire en respectant deux éléments essentiels : le principe de précaution et le droit de recours.
La précaution élémentaire consiste en effet à ne pas financer une entreprise ou un État à propos duquel existent des indices sérieux de violation des critères retenus. En vertu de ce principe de précaution, devraient figurer dans la liste, non seulement les entreprises et les États pour lesquels il existe une vérité judiciaire quant à la violation des critères retenus, mais également ceux pour lesquels il existe de simples indices de culpabilité, pour autant qu'ils soient sérieux. A l'inverse, les entreprises et États repris disposeraient d'un recours pour contester la décision de les placer dans la liste noire.
Bernard Bayot - Mars 2008
La Belgique a signé et ratifié nombre de textes internationaux qui visent à la défense et à la promotion des droits humains et de l'environnement. Fort bien ! Mais elle pourrait aller plus loin en développant une politique cohérente en matière d'investissement public, mais aussi privé.
Ordonnance visant à imposer des critères d'investissements socialement responsables aux marchés financiers de pouvoirs publics
1er JUIN 2006. - Ordonnance visant à imposer des critères d'investissements socialement responsables aux marchés financiers de pouvoirs publics (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à larticle 39 de la Constitution.
Art. 2. Dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 18bis est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit, pour la Région de Bruxelles-Capitale :
« § 3. La Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs adjudicateurs régionaux, financés ou contrôlés mjoritairement par la Région et les communes imposent dans les marchés financiers qu'ils lancent qu'au moins dix pour cent des sommes investies le soient dans des fonds de placements, produits financiers ou mandats de gestion gérés selon un processus d'investissement qui intègre, en plus des critères financiers des critères sociaux, éthiques ou environnementaux, ou dans des sociétés ou associations sans but lucratif qui font application des principes de base visés à l'article 1er, paragraphe 2, 1°, de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale.
Le processus d'investissement précisera dans quelle mesure des critères sociaux, éthiques ou environnementaux sont pris en compte dans la gestion. Le respect des critères sociaux, éthiques ou environementaux fera l'objet, d'une part, de rapports clairs et réguliers par la société de gestion et, d'autre part, d'une contrôle régulier par un organisme indépendant. »
Art. 3. Le gouvernement fait chaque année rapport au Parlement sur la politique menée en matière d'investissement socialement responsable par la Région. Ce rapport est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
Art. 4. L'article 68 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est complété par le paragraphe suivant :
« § 9. Le Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale rédige chaque année un rapport qui doit contenir des informations sur la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière du Centre. Ce rapport est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. »
Art. 5. A l'article 96 de la Nouvelle loi communale, un nouvel alinéa rédigé comme suuit est inséré entre le troisième et la quatrième alinéa :
« Le rapport doit contenir en outre des informations sur la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux dans la politique financière de la commune. »
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle doit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,
B. CEREXHE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK
_______
Note
(1) Session ordinaire 2005-2006 :
Parlement :
Documents. - A-237/1 : Proposition d'ordonnance. - A-237/2 : Rapport. - A-237/3 : Amendements après rapport. - A-237/4 : Rapport complémentaire.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 12 mai 2006.
L'investissement socialement responsable - document de base
Cadre de l'ISR
On distingue généralement trois grandes approches de l’investissement socialement responsable.
Une approche active, en fonction de l'engagement ou de l'activisme actionnarial auprès des entreprises du portefeuille de placement. L'activisme actionnarial consiste à exercer son pouvoir d'actionnaire, par le biais de son droit de vote, aux assemblées générales des entreprises cotées en Bourse afin d'améliorer le comportement éthique, social et/ou écologique de l'entreprise dont on est actionnaire, en favorisant le dialogue avec les dirigeants, en exerçant des pressions, en soutenant une gestion responsable, en proposant et en soumettant au vote des assemblées générales annuelles des préoccupations sociétales.
Une approche passive, en fonction de l'application de filtres positifs ou négatifs sur la base de critères éthiques, sociaux ou environnementaux, au moment du choix de placement. On parle dès lors de « screening » ou de « tamisage positif ou négatif de l'univers d'investissement ».
Le screening négatif, ou screening d'exclusion, consiste à exclure de son univers d'investissement des entreprises impliquées dans certains secteurs d'activités ou produits et services. De nos jours, les secteurs qui sont remis en question sont généralement : l'armement, l'énergie nucléaire, le tabac, l'alcool, le pétrole, etc. Les pays qui posent problème sont les pays non démocratiques, non respectueux des droits de l'homme ou des conventions de l'Organisation internationale du travail. Quant aux pratiques controversées, citons, à titre d’exemples, les manipulations génétiques, les tests sur les animaux, les organismes génétiquement modifiés…
L'exclusion sera soit globale – exclusion de l’ensemble du secteur d'activité ou exclusion géographique –, soit nuancée – exclusion des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires proviennent d'une activité considérée négative, par exemple la vente d'armes.
A contrario, le screening positif ou screening d'inclusion vise à inclure dans l'univers d'investissement les entreprises qui affichent des pratiques exemplaires ou, du moins, qui adoptent les meilleures pratiques de leur catégorie – technique dite de « best-in-class » –, ou qui apportent une contribution significative au développement durable, par exemple.
Une approche communautaire (ou solidaire ou de partage) en fonction des investissements communautaires ou des investissements dits « de partage solidaire ». On sélectionne, ici, les produits financiers de différentes formes qui visent à fournir du capital en prêtant à des entreprises locales ou à des particuliers ou en faisant des investissements sous forme de participation dans de telles entreprises en vue de favoriser le développement communautaire ou d’appuyer les groupes défavorisés ou à faibles revenus ou de développer l'économie locale ou sociale.
Placements éthiques
De quoi s'agit-il ?
Il s’agit de placements financiers dont le capital est exclusivement investi au sein d'entreprises, qui au-delà des critères financiers traditionnels, respectent des valeurs sociales et environnementales précises. L’éthique se traduit donc, dans le domaine financier, par une sélection qualitative d'entreprises socialement responsables dans lesquelles l'investisseur accepte de placer son argent.
Comment fonctionne un placement éthique ?
Comme tout autre produit financier, mais les entreprises qui font partie du portefeuille d’investissement sont évaluées suivant des critères extrafinanciers.
On regroupe généralement ces critères extrafinanciers sous deux grandes catégories :
- les critères d'exclusion, qui, comme leur nom l’indique, excluent de l’univers d’investissement certaines entreprises en fonction de leur activité : armement, énergie nucléaire, manipulation génétique, etc. ;
- les critères positifs, qui sélectionnent dans le portefeuille des entreprises respectant des critères sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance.
- Aujourd'hui, les placements financiers éthiques se classent généralement selon trois catégories.
Les fonds d’exclusion : les gestionnaires de ces fonds excluent de leur univers d’investissement des entreprises impliquées dans certains secteurs d’activités ou produits et services. L’exclusion porte généralement sur plusieurs critères éthiques (armement, tabac, alcool…)
L’exclusion sera soit globale – exclusion de l’ensemble du secteur d’activité ou exclusion géographique –, soit nuancée – par exemple, exclusion des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d’affaires proviennent de la vente d’armes ou exclusion de l’entreprise si elle pratique des tests sur les animaux à des fins non médicales, etc.
Les fonds thématiques ISR qui incluent dans la sélection des entreprises entrant dans l’univers d’investissement une série de critères positifs propres à un secteur ou à un thème. Ces fonds investissent leurs capitaux au sein d’entreprises se distinguant dans un aspect bien précis de la gestion socialement responsable tel que, par exemple, la mise en oeuvre d’une politique sociale adéquate ou la mise en place d’un processus de production écologiquement plus responsable. Pour ces fonds, les entreprises sont donc uniquement analysées sous l’angle d’un ou de plusieurs aspects de gestion socialement responsable (respect de l’environnement, bonne politique sociale, bonne gouvernance), mais pas en fonction de tous ces aspects à la fois.
Les fonds « best-in-class », dans lesquels l’univers d’investissement est composé d’entreprises leaders en termes de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance au sein d’un secteur ou d’un groupe d’entreprises.
La sélection des entreprises est faite soit par des organismes spécialisés indépendants, soit par une cellule de recherche interne à la banque ou au promoteur du produit.
Pourquoi investir « éthique » ?
- Pour une question de morale personnelle.
- Pour encourager les entreprises soucieuses de l'homme et de son environnement.
- Pour concilier intérêt particulier et bien commun.
- Pour construire un monde durable.
À qui les produits éthiques sont-ils destinés ?
- À tout particulier ou toute personne morale qui désire placer son argent à court, moyen ou long terme.
- La gamme des placements éthiques existant s'étend du compte d'épargne au fonds de placement, en passant par des produits d'assurance et d’investissement éthique avec partage solidaire.
Placements éthiques avec partage solidaire
De quoi s'agit-il ?
Les placements avec partage solidaire sont des placements financiers qui soutiennent des associations humanitaires, des projets à plus-value sociale... grâce à la redistribution d'une partie des bénéfices dégagés par le placement de l’épargne.
Le mécanisme de solidarité porte, non pas en amont sur le capital placé, mais en aval sur la redistribution d’une partie des bénéfices éventuels engendrés par le placement du capital. Un placement de partage solidaire place donc son capital selon les critères financiers traditionnels dans des entreprises cotées en Bourse, dans des institutions nationales ou des États, mais redistribue (partage) une partie des bénéfices engendrés par le placement du capital à des associations humanitaires, projets à plus-values sociales…
L'acte « socialement responsable » se situe donc dans le partage des bénéfices générés.
Comment fonctionne un placement de partage solidaire ?
Comme tout autre placement financier, mais une partie des bénéfices sont redistribués au secteur associatif ! Vos bénéfices d’investisseur ? Pas forcément ! Tout dépend du mécanisme de solidarité en vigueur sur le produit choisi.
Actuellement deux mécanismes de solidarité prévalent :
- soit le promoteur (banque, assurance, société de gestion) cède systématiquement une partie des bénéfices qu’il a réalisés sur le produit (partage des droits d'entrée ou de gestion, cession d’un montant forfaitaire…) au profit d’une association bénéficiaire, et l'investisseur a l’option de céder, lui aussi à une association bénéficiaire, une partie de ses bénéfices s’il le désire;
- soit l'investisseur cède une partie de ses gains (intérêts ou dividendes) au profit d’une association bénéficiaire;
- soit le promoteur et l'investisseur cèdent chacun une partie de leur bénéfice.
Qui peut être bénéficiaire de produits solidaires ?
Toute association, toute entreprise de l'économie solidaire ou tout projet porteur de valeurs de développement durable (voir la liste).
Pourquoi investir « solidaire » ?
- Pour servir une économie citoyenne.
- Pour soutenir un grand nombre d'associations, de projets… qui disposent de moyens limités au regard de leur mission (pauvreté, exclusion, protection de la nature…).
- Pour renforcer la cohésion sociale.
- Pour construire une société plus juste et plus humaine.
À qui les produits de partage solidaire sont-ils destinés ?
À tout particulier ou toute personne morale qui désire placer son argent à court, moyen ou long terme.
La gamme des placements financiers de partage solidaire existants s'étend du compte d'épargne au fonds de placement, en passant par des produits d'assurance.
Investissements éthiques et solidaires (directs ou indirects)
De quoi s'agit-il ?
On parle d'« investissement éthique et solidaire » lorsque des particuliers ou institutionnels décident d'investir directement une partie de leurs fonds dans des organisations ou entreprises non cotées en Bourse et appartenant au secteur de l’économie sociale, afin de leur donner les moyens nécessaires pour développer leurs activités. Un investissement sera considéré comme solidaire si au minimum 50 % de son encours total est placé selon ces principes. En Belgique, certaines formules d’investissement éthique et solidaire (ou de capital solidaire) permettent d’investir 100 % du capital dans des intermédiaires financiers solidaires.
On pense ici aux produits non bancaires tels que les parts de coopérateur, les prises de participation de sociétés à finalité sociale ou les obligations émises par des associations ou des fondations.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Comme toute prise de participation dans le capital d'une entreprise, à la différence près que vous n'investissez qu'au sein de structures alternatives à finalité sociale – des ASBL, des fondations, des coopératives agréées, des sociétés à finalité sociale.
Pourquoi investir « éthique et solidaire » ?
- Par conviction personnelle.
- Pour allouer des fonds à des personnes ou institutions qui ont des difficultés à lever des capitaux par le biais des canaux classiques.
- Pour partager le risque de l'investissement lui-même.
- Pour tenter de réduire les inégalités sociales, les phénomènes d'exclusion, la pauvreté...
À qui les produits d’investissement éthiques et solidaires sont-ils destinés ?
À tout particulier ou toute personne morale qui désire placer son argent hors du système bancaire à court, moyen ou long terme, dans des structures à plus-value sociale forte et qui ne recherche pas une grande rentabilité financière.
La gamme des investissements éthiques et solidaire existants s'étend des parts de coopérateur aux groupes d'épargne de proximité, en passant par l'émission d'obligations.
Voir la liste des produits éthiques et solidaires disponibles en Belgique.
Activisme actionnarial
De quoi s'agit-il ?
L’activisme actionnarial (ou shareholder activism) consiste à exercer son pouvoir d'actionnaire, par le biais de son droit de vote, aux assemblées générales des entreprises cotées en Bourse afin d'améliorer le comportement éthique, social et/ou écologique de l'entreprise dont on est actionnaire, en favorisant le dialogue avec les dirigeants, en exerçant des pressions, en soutenant une gestion responsable, en proposant et en soumettant au vote des assemblées générales annuelles des préoccupations sociétales.
L'activisme actionnarial est donc un moyen complémentaire mis à la disposition de tout investisseur en vue de contribuer au développement durable de la société.
Comment l’activisme actionnarial fonctionne-t-il ?
L'investisseur exerce son pouvoir d'actionnaire (notamment son droit de vote) en participant aux assemblées générales.
Pourquoi devenir un actionnaire actif ?
- Pour infléchir de manière responsable la stratégie des entreprises.
- Pour interpeller les dirigeants d'entreprises sur leur mode de gestion.
- Pour dénoncer des pratiques peu responsables
Qui peut faire de l’activisme actionnarial ?
Tout particulier ou toute personne morale détentrice d'un nombre d'actions d'entreprises suffisant pour participer aux assemblées générales annuelles.
L'épargne éthique : document de base
À chaque produit son éthique
L'éthique n'est pas une donnée universelle. Elle varie, bien au contraire, en fonction des cultures, des convictions, des époques et des lieux.
L'éthique dans les produits financiers n'échappe pas à cette règle et, derrière les termes investissement éthique et investissement socialement responsable, se cache « une grande diversité d'investisseurs, de visions du monde, de préférences culturelles, de logiques et de stratégies » (Paule de Prémont, Les enjeux éthiques des fonds éthiques, Finance & the Common Good / Bien Commun N° 8 - Investissements Socialement Responsables (Automne 2001).
L'offre des placements financiers éthiques est donc à éthique diverse et variable.
À chacun d'opérer, en fonction des valeurs auxquelles il adhère, des choix qui lui sont propres.
Évaluation des entreprises – Par qui ?
Deux courants s'opposent. Soit ce sont les promoteurs des produits eux-mêmes – banques, gestionnaires de fonds – qui sélectionnent les entreprises socialement responsables grâce à une cellule de recherche propre (ou département in-house). Soit ceux-ci font appel aux services d'un bureau d'études spécialisé indépendant.
Les méthodes de sélection sont diverses, allant de la seule notation des entreprises par le bureau d'études, qui laisse au gestionnaire financier le choix final d'investir ou non dans une société mal cotée éthiquement, au screening (filtrage) qui limite ce choix à un univers d'investissement bien précis, délimité par le bureau d'études. On parlera dès lors, respectivement, d'« agences de notation » ou de « bureaux de screening ».
Les critères éthiques
Pour évaluer si une entreprise a un comportement socialement responsable vis-à-vis de la société, une série de critères dits « éthiques » sont définis par différents organismes spécialisés.
Bien entendu, chaque organisme, et, a fortiori, chaque produit a ses nuances en matière de critères éthiques.
On peut néanmoins les regrouper en deux grandes catégories :
Les critères négatifs ou d'exclusion
Ils excluent du portefeuille d'investissement certaines entreprises en fonction de la nature, du lieu, de la pratique..., de leurs activités.
Quelques exemples :
- Les pays : les pays non démocratiques, non respectueux des droits de l'homme, des conventions de l'Organisation internationale du travail...
- Les pratiques controversées: les manipulations génétiques, les tests sur les animaux
L'exclusion sera soit globale (exclusion de l'entièreté du secteur d'activité, exclusion géographique), soit nuancée (p. ex. : exclusion des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires provient de la vente d'armes, exclusion de l'entreprise si elle pratique des tests sur les animaux à des fins non médicales...).
Les critères positifs de sélection
Ils évaluent les entreprises selon deux, voire trois, grands axes caractéristiques de la notion de « développement durable » :
- Social : gestion des ressources humaines, relation de l'entreprise avec les autorités locales, les clients, les actionnaires, les pays en voie de développement, programmes de non-discrimination, contribution dans des œuvres sociales, respect des droits de l'homme...
- Environnement : minimalisation des impacts sur l'environnement, gestion du risque, protection des ressources naturelles...
- Bonne gouvernance : pérennité financière, potentiel économique, mondialisation...
L'entreprise sera généralement évaluée, pour chacun des axes, sur trois plans : les stratégies politiques et engagements pris par la direction en la matière ; les politiques et codes de conduite effectivement mis en place ; et, enfin, leurs résultats.
Contrôle et garantie de l'éthique
Responsabilité du promoteur
Le caractère éthique d'un produit financier est de la responsabilité de son promoteur. Celui-ci affecte les fonds qui lui sont confiés en respectant le cahier des charges éthiques qu'il s'est fixé. En règle générale, il s'assurera, à cet effet, les services d'un bureau d'études spécialisé, indépendant ou non.
Responsabilité des bureaux d'études spécialisés
Les bureaux de screening/agences de notation spécialisés dans l'analyse sociétale des entreprises sont les mieux placés pour se porter garant du respect des critères éthiques. Les politiques de contrôle en la matière varient d'un organisme à l'autre. Les plus consciencieux réévalueront l'entreprise sélectionnée de manière approfondie tous les trois ans, tout en la suivant de manière permanente tout au long de l'année. Si un problème vient à se manifester, l'exclusion de l'entreprise de l'univers d'investissement éthique peut être immédiate.
Responsabilité de l'investisseur
Les produits financiers éthiques se présenteront sous des jours très différents selon la nature des critères retenus, la méthodologie, la qualité du travail et l'indépendance du bureau d'études spécialisé. À l'investisseur de s'assurer que la démarche éthique du produit correspond bien à la sienne. L'investisseur ne peut déléguer sa responsabilité d'investisseur en achetant un produit socialement responsable sans se renseigner sur le fondement et les principes de l'éthique du produit. D'autant que l'engouement pour ces produits depuis quelques années incite plus d'un intermédiaire financier à jouer la carte de l'éthi-marketing. À l'investisseur d'être vigilant et critique sur la qualité de l'éthique qui lui est proposée.
Responsabilité d'autres acteurs économiques
Les organismes de protection des consommateurs, de promotion de l'investissement socialement responsable, les ONG, etc., ont également un rôle de garant de l'éthique à jouer en interpellant les bureaux de notation, les banques, les entreprises...
Existence de garde-fous
À l'instar des labels bio, l'existence de labels/certifications éthiques issus d'organismes indépendants est un outil utile pour s'assurer de la qualité éthique d'un produit. Il est donc essentiel que des labels construits sur des cahiers de charges et des outils d'évaluation sérieux et complets réussissent à s'imposer davantage.
Notons, à titre exemple, le label européen de référence : le label ETHIBEL, issu du monde associatif.
Pagination
- Page précédente
- Page 63
- Page suivante