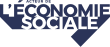Banques durables : une alternative d'avenir ?
L'actu : plusieurs organismes bancaires français proposent à leur clients des placements solidaires dans des projets environnementaux, sociaux et culturels. Dans un contexte de crise économique mondiale, cette offre alternative attire de plus en plus les entreprises et les particuliers.
Une norme pour les investissements financiers socialement responsables
Le changement climatique : protocole de Kyoto et échange de permis d'émission
Mécanismes de flexibilité
Les scientifiques sont formels, nous sommes en grande partie responsables des changements climatiques actuels! La principale cause : les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES), principalement dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, que nous rejetons dans l'atmosphère en quantité exponentielle depuis la révolution industrielle. Mais comment faire pour endiguer cette tendance ? Le protocole de Kyoto, adopté en 1997 et entré en vigueur en février 2005 suite à sa ratification par la Russie, tente d'y remédier en contraignant les pays industrialisés signataires de réduire le total de leurs émissions de GES de 5,2 % par rapport à 1990, pour la période 2008-2012.
Pratiquement, le protocole de Kyoto alloue des quotas d'émission aux pays signataires. Pour faire simple, un quota représente un droit d'émettre 1 tonne d'équivalent CO2, soit une quantité fixe de gaz à effet de serre qui peut être rejetée annuellement par le pays en question dans la période 2008-2012.
La Belgique par exemple devra réduire pour 2008-2012 ses émissions de GES de 7,5 % par rapport à 1990, c'est-à-dire qu'elle aura le droit durant cette période d'émettre annuellement 92,5 % de ses émissions au niveau de 1990. Comme la Belgique émettait 146 millions de tonnes de CO2 en 1990 (transports aérien et maritime exclus), elle recevra 146*0,925= 135 millions de quotas chaque année entre 2008-2012.
Pour réaliser leur engagement, les pays ont le choix des instruments : soit via des "actions domestiques", soit en recourant aux puits de carbone, soit en utilisant les mécanismes de flexibilité prévus dans le protocole de Kyoto (PK). Car l'un des objectifs du protocole est de réduire les concentrations de GES, tout en permettant que le développement économique puisse se poursuivre de manière durable.
Toutefois, il est clairement stipulé que les actions domestiques doivent constituer une part significative de l'effort fourni. Le recours aux mécanismes flexibles vient donc en complément.
Attardons-nous sur les trois mécanismes de flexibilité proposés: la Mise en Oeuvre Conjointe – Joint Implementation Mechanism, le Mécanisme de Développement Propre – Clean Development Mechanism et les droits d'émission négociables – Emission Trading.
La Mise en Œuvre Conjointe et le Mécanisme de Développement Propre consistent à mettre en œuvre des mesures de réduction d'émission dans un autre pays que le sien. Soit dans un pays développé (repris à l'annexe I du protocole), on parlera, dans ce cas, d'un projet de mise en œuvre conjointe; soit dans un pays dit en voie de développement et l'on parlera, alors, d'un projet de développement propre.
L'objectif est double. D'une part, stimuler le transfert de technologies respectueuses du climat ainsi que les connaissances y afférentes et de contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique tout en soutenant le développement des pays les moins favorisés. Et, d'autre part, réaliser les réductions d'émissions là où elles coûtent le moins cher, c'est-à-dire là où, par exemple, se trouvent les installations industrielles les moins performantes sur le plan énergétique.
Ces deux mécanismes permettent au pays initiateur et investisseur du projet d'obtenir des crédits d'émission.
Un exemple : la firme anglaise Rolls Royce qui a conçu un projet permettant de produire de l'électricité à partir de cosses de riz en Thaïlande. L'électricité produite au moyen de cette biomasse permet d'éviter le rejet de 83 000 tonnes de CO2 en moyenne par an. Rolls Royce recevra un crédit d'émission équivalent aux réductions d'émission engendrées par le projet. Intérêt pour Rolls Royce ? Réaliser une réduction équivalente chez elle aurait été plus onéreux, de plus cela permettra à Rolls Royce de compenser l'éventuel dépassement de son quota d'émission sur le territoire national. Intérêt pour la Thaïlande ? Bénéficier d'un transfert de technologie et d’un impact environnemental positif[1].
Bien entendu, ces mécanismes de projet sont réglementés, encadrés et contrôlés par des entités indépendantes et par un organe de contrôle de la Convention climat. Néanmoins, si l'intégrité environnementale du projet est scrupuleusement garantie par le Comité exécutif des Nations Unies, l'objectif de contribuer au développement durable du pays hôte ne fait pas à ce stade l'objet d'un contrôle ou d'une vérification à proprement parler. Elle est laissée à l'initiative de l'autorité nationale du pays hôte. Une simple attestation de sa part suffit.
Le troisième mécanisme concerne, quant à lui, l'échange des droits d'émission négociables. Le protocole de Kyoto prévoit dans son article 17 la mise en place d'un marché international de droits d'émission de gaz à effet de serre qui doit débuter à partir de 2008. Ce marché, qui fonctionnera comme n'importe quelle bourse aux matières premières, permettra l'achat/vente des permis d'émission entre les pays visés à l'Annexe B aux fins de remplir leurs engagements Kyoto.
Le protocole de Kyoto autorise donc les pays à échanger entre eux leurs quotas d'émission en spécifiant toutefois que cette mesure vient en complément des mesures prises au niveau national.
Système européen d’échange de quotas d’émission
Pour s'y préparer l’Union européenne (UE) a ouvert, au 1er janvier 2005, au sein de l'Europe des 25 son propre marché domestique de quotas d'émission (EU ETS – European Union Emissions Trading Scheme- système d'échange de quotas d'émission). L'objectif de l’UE par ce projet interne est clairement de respecter ses engagements Kyoto tout en nuisant le moins possible au développement économique et à l'emploi des Etats membres.
Ce système organise, en effet, l'échange des émissions entre les entreprises[2] issues des cinq secteurs industriels les plus polluants de l'Union européenne (électricité, fer et acier, verre, ciment, papier). Il vise à aider les entreprises à atteindre leurs normes d'émissions de la façon la plus souple et la moins chère qui soit. Ces dernières ont le choix entre réduire leurs propres rejets en investissant dans l'innovation et les technologies plus propres ou en achetant des "droits de polluer" à d'autres entreprises de l'UE ou de pays en voie de développement. Les entreprises devront donc optimiser leur choix en comparant la proportion entre les frais d'investissements et le prix du marché des droits d'émission établi en fonction de l'offre et de la demande.
Que penser de ce marché européen d'échange de droits d'émission ?
Dans son principe, ce système offre aux industriels un maximum de flexibilité et leur permet de réduire leurs émissions à un moindre coût, ce qui, en soi, est favorable et incite à la mise en œuvre d’un comportement climatique responsable, bénéfique pour tous et à tout point de vue à long terme.
Néanmoins ce système d'échange a déjà montré certaines limites et certaines actions ont déjà été envisagées afin de le rendre efficace.
Citons comme préoccupation principale l'allocation des quotas d'émission aux entreprises. En effet, les entreprises se sont vues allouer un surplus de quotas d'émission de CO2 pour la période 2005-2007, ce qui a entraîné la chute des prix du carbone mettant ainsi en péril la crédibilité et l'efficacité du système. Les prix sont passés de 11 à 14 €/t en février 2004 à 7 €/t deux mois plus tard, suite à l'annonce des plans nationaux d'allocation des quotas. Aujourd'hui, le prix oscille autour de 6 €/t. Cette chute de prix n'incite en rien les entreprises à s'orienter davantage vers l'innovation et l'investissement en nouvelles technologies propres. Il faut donc impérativement que le marché donne un prix significatif au carbone. Pour cela une limitation de l'offre en allouant des quotas d'émission plus exigeants s'impose.
Autre préoccupation, les quotas d'émission ont été alloués gratuitement aux entreprises. Ce système d'allocation leur a permis d'accumuler des bénéfices considérables, grâce d'une part à la vente de leur surplus de crédit mais grâce également au fait que les entreprises répercutent le coût de la pollution sur le consommateur final, empochant ainsi un double pactole. Exemple en Allemagne, où l'électricité, en grande partie produite à partir du charbon, a vu ses prix d'électricité durant les heures creuses doublés en deux ans.
Troisièmement, il faudrait inclure dans ce système d'échange d'autres secteurs d'activités économiques, tel que le secteur de la chimie ou celui des transports par exemple, qui est l’un des plus grands responsables des rejets de CO2 dans l'atmosphère.
Terminons en soulignant la problématique de l'échéancier court terme de Kyoto 2008-2012. En effet, de par cet échéancier, à l'heure actuelle ce sont les projets à court terme et les plus rentables qui rencontrent l'intérêt des spéculateurs, et ce au détriment de projets aux perspectives à plus long terme tel l'investissement dans les énergies renouvelables.
Néanmoins, ce système a le mérite d'apporter un début de solution à la problématique extrêmement vaste, complexe et mondiale qu'est le changement climatique. Malgré certaines lacunes, il permet des avancées intéressantes par le biais d'investissement dans la recherche de technologies plus propres, par le transfert de technologies et d'aides à la réduction d'émissions de CO2 dans les pays en voie de développement et en pleine phase de croissance économique. Ce n'est peut-être encore qu'une faible part mais c'est un début! Il faudra néanmoins garder bien à l'œil que ces mécanismes de flexibilité de Kyoto ne peuvent être qu'une aide complémentaire pour atteindre des engagements et ne peuvent en aucun cas supplanter les actions domestiques à mettre en œuvre, dans le cas contraire il faudrait revoir drastiquement les mécanismes de flexibilité dans leur ensemble.
Alexandra Demoustiez,février 2007
Références
§ Mechanisms, Emissions Trading – Kyoto Portocol, http://unfccc.int
§ Le Système Européen d’Echange de quotas d’émission, février 2007, http://www.euractiv.com/fr/developpement-durable/systeme-europeen-echange-quotas-emissions-ets/article-133881
§ Directive 2003/87/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 Octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
§ Emissions Trading directive a significant step forward, says, NGO’s, CAN, WWF, Greenpeace, RSPB, Friends of the Earth, juillet 2006
§ « Analyse du RAC-F sur le fonctionnement du marché européen de quotas d’émission. L’exemple du laxiste Plan National d’Allocation de Quotas français et propositions de réformes pour l’avenir », RAC-F, septembre 2005
§ « Les économistes européens et le WWF exigent un système d’échange de droits d’émissions plus rigoureux, climat », WWF, novembre 2006
§ « Action 24 : une meilleure solidarité : recourir aux mécanismes flexibles », plan fédéral de développement durable 2004-2008
§ « La grande foire des permis de polluer », extraits the Economist, Courrier International hors-série, octobre, novembre, décembre 2006
[1] IRES- « Le mécanisme pour un développement propre, ou comment faire d’une pierre deux coups », Regards Economiques, janvier 2005, numéro 27.
[2]Pour rappel, Kyoto concerne les pays.
Le protocole de Kyoto prévoit différents mécanismes dits ‘flexibles' afin de permettre aux pays signataires de réaliser leurs engagements à moindre coût économique. Que penser des marchés de permis de polluer ?
De Ace à Grameen Bank
Au début du mois d’octobre l’Ace Bank s’est ouverte en Belgique. Pour son administrateur délégué, Monsieur Hayes, elle a l’ambition de devenir le Ryanair du monde financier. « De nombreuses banques ne sont encore nulle part en matière de réduction interne des coûts. Le client paie la facture de prestigieux projets de construction, de la façade affichée en matière de durabilité ou des salaires élevés dans le secteur financier. Chez ACE bank, nous faisons le choix d'une réduction draconienne des coûts. Nous sous-traitons la majeure partie de nos services et notre personnel est payé en fonction du rendement qu'ils génèrent pour les clients. Nous voulons devenir le Ryanair du monde bancaire. »
En matière d’investissement, ACE bank privilégie la rentabilité à tout prix. Elle propose plusieurs fonds et promet un rendement élevé grâce à une stratégie dépourvue de toute considération sociale ou environnementale. Free Labour Found investit uniquement dans les sociétés qui maximalisent leur marge en profitant de coûts salariaux plancher au Bangladesh ou en Chine, Global Change Fund investit dans les sociétés spécialisées dans les activités telles que l'extraction de pétrole dans les zones de conflit, Enduring Freedom Fund propose quant à lui un portefeuille d'actions de fabricants d'armes,...
Quelques jours plus tard, la baudruche s’est dégonflée. ACE bank n’était autre qu’un canular de nos complices de Netwerk Vlaanderen qui entendaient ainsi stigmatiser, par l’absurde, les investissements non éthiques des banques.
Il n’empêche, l’offre d’investissements non éthiques d’ACE bank et son discours dépourvu du moindre scrupule semblent avoir si peu dénoté dans le monde bancaire belge que celui-ci n’y a manifestement vu que du feu… Jusqu’à la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) qui a déposé plainte contre ACE bank pour avoir opéré sur le marché belge sans être en possession des autorisations nécessaires ! Et que dire de La fédération financière belge, Febelfin, qui, interrogée sur la politique éthique des banques, a soutenu la liberté de chacune d'entre elles à décider de leur propre stratégie afin de répondre à la demande de leurs clients. Et de renforcer cet argument en citant une étude de Het Nieuwsblad, selon laquelle 80 % de la population ne se préoccupent de toute façon pas de l'utilisation que les banques font de leur argent. Preuve s'il en est que le service à la clientèle doit avant tout primer sur la responsabilité éthique des banques!
Netwerk Vlaanderen a ainsi eu beau jeu de relever qu’une telle offre non éthique existe bel et bien dans la réalité, même si c’est de façon plus diluée. Et de rappeler qu’un rapport établi en novembre 2005 chiffrait à 8 milliards de dollars les investissements des grands groupes bancaires belges (Axa, Dexia, Fortis, ING et KBC) dans des sociétés qui ne respectent pas les droits de l'homme.
Le banquier des pauvres
Pendant ce temps, le 13 octobre 2006, le prix Nobel de la paix 2006 était décerné conjointement au Bangladais Muhammad Yunus et à une établissement bancaire, la Grameen Bank, les deux fondateurs du micro-crédit. L'homme et l'institution, qui partageront ce prix attribué depuis 1901, sont récompensés pour leurs efforts pour promouvoir le développement économique et social dans leur pays en favorisant des programmes économiques innovants tels que les micro-emprunts.
L'activité de micro-crédit consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des entrepreneurs ou des artisans qui ne peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Dans le Bangladesh rural, pour sortir de la pauvreté et échapper aux usuriers et intermédiaires, les paysans sans terre ont besoin d’un accès au crédit, sans lequel ils ne peuvent lancer leurs propres entreprises, aussi petites soient-elles. Cet accès au crédit leur était refusé dans le monde rural traditionnel, en l’absence de garantie (dans ce cas-ci, le défaut de terre). L’offre bancaire et financière marchande était donc inadéquate et la nécessité d’accéder au crédit a fait naître le projet de la Grameen Bank1 dans le village de Jobra en 1976. Ce projet a renversé la pratique bancaire habituelle en enlevant le besoin de garantie et a créé un système bancaire basé sur la confiance, la responsabilité, la participation et la créativité mutuelle.
La pauvreté, explique Yunus, découle souvent de l’incapacité des travailleurs à bénéficier des fruits de leur labeur, parce qu’ils n’ont pas le contrôle du capital. Les pauvres servent, en fait, ceux qui détiennent ce capital. Non seulement ils n’en sont pas les héritiers, mais ils ne peuvent rien faire puisqu’on leur refuse l’accès au crédit. Au fil des années, on a fini par admettre comme une évidence l’idée selon laquelle on ne peut pas faire confiance aux pauvres en matière d’argent. Mais s’est-on jamais posé la question opposée, et bien plus fondamentale : les banques, elles, sont-elles dignes de confiance, à l’échelle humaine ? 2
La « banque des pauvres » a quant à elle rapidement progressé puisqu’en juillet 2004, la Grameen Bank comptait 3,7 millions de clients au Bangladesh. Avec 1.267 succursales, la banque offre ses services à 46.000 villages, couvrant plus de 68 % des villages du pays. Elle affiche en outre un taux de remboursement plus élevé – 99,06 % en décembre 2003 – que dans les cas de crédits classiques !
Parmi les clients de la banque, 96 % sont des femmes. Ce rôle prépondérant joué par les femmes dans le micro-crédit est une volonté de ses concepteurs : au lieu de prêter au chef de foyer (un homme dans la plupart des cas), ils ont en effet focalisé leur action sur les femmes, explique Yunus. Etre pauvre au Bangladesh est dur pour tout le monde, et l’est davantage encore quand on est une femme. Mais, lorsque les mères de famille se voient offrir une possibilité de s’en sortir, si modeste soit-elle, elles se révèlent plus combatives que les hommes... L’expérience le prouve : le crédit, lorsqu’il passe par les femmes, amène des changements plus rapides que lorsqu’il passe par des hommes. Il ne s’agissait donc pas seulement de leur donner la place qui leur revenait, mais bien davantage de les considérer comme des acteurs privilégiés du développement. Et les femmes ont été, en effet, notre arme la plus efficace contre la pauvreté.3
Télescopage
Ente ces deux événements, l’ouverture de l’Ace Bank et l’attribution du Nobel à Yunus, le calendrier a placé quelques jours seulement ; là où des années-lumière les séparent !
La finance, obtenir des ressources monétaires et les allouer, peut être une fin en soi ou avoir d’autres visées. Soit constituer une pratique volontairement déconnectée de la réalité, qui se suffit à elle-même et qui, pour tout dire, a des tendances schizophréniques. Soit prendre en considération les relations sociales dans lesquelles elle s’inscrit et pour lesquelles elle a été créée.
D’un côté, elle est et se revendique irresponsable, dans le sens premier du terme, car hors de la réalité dont elle ne doit par conséquent pas tenir compte, ni répondre. Elle demeure imperturbablement étrangère au moindre scrupule, dépourvue de toute considération sociale ou environnementale. Sa seule visée et sa seule raison d’être est le profit, envers et contre tout. Qu’importe l’exploitation des travailleurs, rémunérés à des conditions dérisoires, amenés à travailler dans des conditions inacceptables et privés des droits sociaux les plus élémentaires. Qu’importe les démocrates oppressés par des dictatures sanguinaires. Qu’importe les gosses qui tombent sous les bombes à sous-munitions. Qu’importe le réchauffement climatique.
De l’autre, la finance est consciente de sa responsabilité sociale et environnementale. Créée par les hommes, elle est guidée par l’intérêt collectif ou, à tout le moins, celui-ci en constitue un garde-fou.
La finance irresponsable est également inhumaine dans le sens où elle ne place plus l’homme au centre de ses préoccupations et lui retire toujours davantage sa confiance. En n’acceptant pas - ou de moins en moins - des garanties comme la valeur de l’entrepreneur qui sollicite le financement, la validité intrinsèque et les potentialités de développement du projet qu’il soumet ou encore la solidarité d’un groupe dans le remboursement d’un crédit. Ces garanties « humaines » sont délaissées au profit de garanties patrimoniales dont seules les franges plus riches de la population peuvent justifier.
L’autre finance, responsable, met l’homme au centre de ses préoccupations et développe les outils nécessaires, notamment pour l’évaluation du risque, qui permettent de remplir adéquatement sa fonction d’allocation des ressources monétaires.
Il est donc temps, comme le propose Yunus, de retourner la question de la confiance aux banques : sont-elles, elles, dignes de confiance, à l’échelle humaine ? Entre les deux modèles, ACE et Grameen, une infinité de nuances existe sans doute. Mais, après le télescopage de ces deux actualités, qui pourra encore prétendre qu’épargner cent balles, c’est-à-dire choisir l’endroit et la façon de placer son argent, n’est pas, fondamentalement, poser un choix de société ?
Bernard Bayot, novembre 2006
1 Muhammad Yunus, Une banque pour les pauvres, Manière de voir, n° 41, septembre-octobre 1998, page 67 ; voir aussi http://www.grameen-info.org/.
2 Muhammad Yunus, Transgresser les préjugés économiques, Le Monde diplomatique, décembre 1997, pages 14 et 15.
3 Muhammad Yunus, Transgresser les préjugés économiques, op.cit.
L'actualité du mois d'octobre dernier a fait se télescoper deux images bancaires pour le moins contrastées. D'un côté, l'Ace Bank qui, le 11 octobre, a ouvert un bureau à Bruxelles en promettant un rendement élevé grâce à une stratégie dépourvue de toute considération sociale ou environnementale. De l'autre, la Grameen Bank qui, deux jours plus tard, a reçu le prix Nobel de la paix 2006, après avoir permis à des millions d'exclus du système bancaire traditionnel de développer une activité indépendante et d'échapper ainsi à la misère.
Les syndicats et l'investissement responsable
Les expériences syndicales en matière d'investissement socialement responsable (ISR) sont multiples à travers le monde. Développées dans des contextes différents, elles ne sont pas nécessairement transposables. On peut les schématiser en cinq actions, qui peuvent, bien sûr, se cumuler : le boycott, la labellisation, l'actionnariat actif, la gestion des fonds de pension et l'action financière.
Boycott
La première formule consiste à soutenir des mouvements de boycott des investissements dans certains pays (Afrique du Sud du temps de l'apartheid, Chine, Soudan...) ou de certaines entreprises lorsqu'elles se rendent coupables, par exemple, de violation de droits civils ou sociaux.
Labellisation
La labellisation de produits financiers consiste à identifier certains de ceux-ci pour récompenser les producteurs respectant des normes de qualité et pour indiquer ce respect au consommateur. En France, le Comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES), créé en janvier 2002, rassemble presque tous les syndicats représentatifs (CFDT, CFECGC, CFTC, CGT) et publie annuellement une sélection d'offres d'épargne salariale socialement responsable qu'il labellise.
Ses critères de sélection sont de trois ordres : le meilleur rapport qualité-prix pour les salariés, des instruments d’investissement socialement responsables et diversifiés, en fonction du risque et de l’orientation souhaités par le salarié, et enfin des garanties fortes (contrôle par un conseil de surveillance composé majoritairement de représentants des salariés, capacité donnée à ce conseil de contrôler régulièrement et concrètement la gestion des fonds, transparence et clarté de la gestion).
Actionnariat actif
L’activisme actionnarial consiste, pour les actionnaires, à exercer leur droit de vote aux assemblées générales annuelles des entreprises cotées dont ils détiennent des parts. Ils utilisent ainsi un levier puissant pour améliorer le comportement éthique, social et/ou environnemental des entreprises, en favorisant le dialogue avec les dirigeants, en exerçant des pressions, en soutenant une gestion responsable, en proposant et en soumettant au vote des assemblées générales annuelles des préoccupations sociétales.
À l’occasion d’une réunion qui s’est tenue au début du mois d'avril 2003 à Stockholm, l'alliance syndicale internationale Global Unions [1], regroupant la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)[2], les Fédérations syndicales internationales et la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (CSC-OCDE) [3], a décidé d’intensifier ses efforts en vue d’assurer que les entreprises multinationales assument leurs responsabilités sociales.
Les participants, qui ont passé en revue une large gamme d’initiatives volontaires privées en matière de responsabilité sociale, ont notamment examiné l’essor de l’investissement socialement responsable et le rôle que les investisseurs – tels que les fonds de pension, par exemple – peuvent jouer dans ce domaine.
Le sujet n'est pas neuf : depuis un rassemblement international qui a eu lieu à Stockholm également, en 1999, la coopération intersyndicale s'est accrue en vue d'améliorer l’influence des capitaux des salariés.
Sur le plan mondial, l’objectif poursuivi par les organisations syndicales est d’utiliser comme levier d’action le pouvoir des 11 000 milliards de dollars détenus par les travailleurs et investis pour leur retraite, afin d’améliorer les comportements des entreprises et de les rendre plus socialement responsables.
Cette stratégie syndicale se retrouve également sur le plan national.
Aux États-Unis, les syndicats associés à l’American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), qui gèrent presque 1500 fonds, soit environ 400 milliards de dollars d’encours, environ 328,7 milliards d’euros, ont lancé le programme "Capital Stewardship" pour coordonner les activités d’engagement actionnarial, en particulier les résolutions visant à réformer la gouvernance d’entreprise [4].
Ils sont également les auteurs du "Proxy Voting Guidelines", guide du vote par procuration accessible au grand public [5], du "Key Vote Survey", qui dresse une liste des gérants d’actifs et de leur performance de vote sur un nombre sélectionné de résolutions d’actionnaires [6], et de l’"Investment Product Review" qui dresse une liste des canaux d’investissement dans lesquels les fonds des syndicats peuvent investir, car ils créent des "bénéfices collatéraux" ou des retours financiers positifs et défendent des valeurs de travail [7].
Au Royaume-Uni, à l’occasion de la publication d’un rapport intitulé "Working Capital" [8] et d’une conférence qu’elle organisait à Londres, le 24 février 2003, la Confédération syndicale britannique Trade Union Congress (TUC) [9] a adopté une position claire en faveur de l'investissement socialement responsable.
L’objectif qu'elle se fixe est de mobiliser les 260 milliards d’euros détenus par les fonds de pension comportant des administrateurs membres du TUC pour développer des investissements économiquement ciblés afin de combler des fossés sur les marchés de capitaux ou de les orienter sur les projets créateurs ou préservateurs d’emplois ; de désinvestir des entreprises qui ont un comportement social inacceptable ; de sélectionner les entreprises sur la base de leur comportement social ; et, enfin, de pratiquer l’engagement actionnarial aux assemblées générales annuelles.
En France, le Comité intersyndical de l'épargne salariale (CIES) envisage également d’expérimenter des campagnes de vote lors des assemblées générales des entreprises.
Gestion des fonds de pension
Les syndicats interviennent également, à des degrés divers, dans la gestion ou le contrôle de la gestion des fonds de pension et peuvent, à ce titre, agir pour promouvoir l'ISR. C'est le cas, par exemple, au Brésil où les syndicats cherchent la participation au marché financier, en particulier dans la politique de création et de gestion des fonds de pension. Pour cette politique, ils s’appuient sur le discours de gouvernance d’entreprise, de responsabilité sociale, d'investissements éthiques et de défenseurs légitimes des droits des travailleurs.
Ce "dialogue" entre syndicalistes et marché financier présente une nouvelle variable dans l’histoire du syndicalisme brésilien, ainsi qu’une nouvelle nature dans le rapport capital/travail. La méthode de recherche a été constituée à partir des entrevues avec plusieurs syndicalistes des centrales syndicales du Brésil, c'est-à-dire, la Centrale unique des travailleurs (CUT), Force syndicale (FS), et la Centrale générale des travailleurs (CGT). Théoriquement, cette recherche s’inspire des travaux de quelques sociologues, tels Robert Castell, et de grands noms de la sociologie du travail du Brésil [10].
Action financière
Deux exemples québécois, la Caisse d'économie Desjardins des travailleuses et des travailleurs et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, montrent enfin la possibilité pour un syndicat de devenir lui-même acteur financier.
La Caisse d'économie Desjardins des travailleuses et des travailleurs (Québec) a vu le jour le 24 février 1971 sous le nom de Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec. À l'initiative de militantes et de militants de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) de la région de Québec, cette caisse délaisse l'action conventionnelle des caisses populaires et d'économie. Elle a proposé, dès le départ, une démarche coopérative militante axée essentiellement sur la promotion de l'action collective. Les militants poursuivent deux objectifs : prendre le contrôle de leur épargne et démontrer qu'il est possible de faire autrement sur le plan économique. La Caisse reste au service des travailleuses et des travailleurs, mais elle met en place une nouvelle stratégie de développement, d'abord sur le plan de la collecte de l'épargne collective par la voie syndicale, et elle s'engage plus à fond auprès des groupes populaires et communautaires. Elle se développera pour beaucoup à partir de coopératives d'habitation et de travail.
Par ailleurs, au début des années 80, le Québec traverse une difficile récession. Près du quart des jeunes sont sans emploi. Plus de 14 % de la main-d'œuvre québécoise est au chômage. Les taux d'intérêt démentiels obligent plusieurs petites et moyennes entreprises à fermer leurs portes. En avril 1982, le premier ministre du Québec, René Lévesque, lance un appel à la solidarité lors du Sommet socio-économique convoqué d'urgence à Québec par le gouvernement québécois.
Consciente de la gravité de la situation, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) se dit prête à collaborer. Louis Laberge, alors président de la FTQ, la plus importante centrale syndicale du Québec propose à ses membres de se doter d'une nouvelle politique syndicale face aux licenciements et aux fermetures d'entreprises. « Nous devons répondre à l'urgence de l'heure chez nos membres et dans la société québécoise : le maintien et la création d'emplois, déclare-t-il. Sinon, à quoi servent les syndicats ? »
Un des moyens préconisés est la création d'un fonds d'investissement de solidarité contrôlé par la FTQ. L'objectif est d'investir du capital de risque dans les PME québécoises. Dans les mois qui suivent, des professionnels de la Société de développement des coopératives et des dirigeants de la FTQ se mettent à l'œuvre. Le gouvernement du Québec exprime son appui en accordant aux futurs actionnaires du Fonds des conditions fiscales avantageuses. Il sera d'ailleurs suivi par le gouvernement fédéral quelque temps après. Le 3 mars 1983, la FTQ annonce son projet de créer le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ), une première dans les annales du monde syndical !
Conclusions
Comme on le voit, les pistes ne manquent aux organisations représentatives des travailleurs pour influencer le cours des choses en matière financière. Correctement utilisé, l'effet de levier dont elles disposent au travers de leurs adhérents et des fonds de pension à la gestion desquels elles sont associées est immense. Mais, pour en faire usage, des évolutions de mentalité sont parfois nécessaires, tant il est vrai que les actions possibles en ce domaine n'appartiennent pas au champ d'activité traditionnel des syndicats.
Les réticences sont plus prononcées, ici ou là, en fonction du type de syndicalisme déployé. Pour certains, c'est une véritable révolution culturelle qui est nécessaire, le cas échéant. Mais ne rien faire, revient à refuser d'apporter une réponse syndicale globale dans un contexte qui, lui, est globalisé.
Bernard Bayot, 3 octobre 2008
[1] http://www.global-unions.org.
[2] http://www.icftu.org/default.asp?Language=FR.
[4] http://www.aflcio.org/corporateamerica/capital.
[5] http://www.aflcio.org/corporateamerica/capital/upload/proxy_voting_guide....
[6] http://www.aflcio.org/corporateamerica/capital/upload/keyvotesurvey2002.pdf.
[7] http://www.aflcio.org/corporateamerica/capital/upload/2002_IPR.pdf.
[8] http://www.tuc.org.uk/pensions/tuc-6269-f0.pdf.
[9] TRADE UNION CONGRESS - Working Capital - www.tuc.org.uk -février 2003.
[10] Maria Aparecida, CHAVES JARDIM, Nouvelles stratégies syndicales au Brésil : création et gestion de fonds de pension.
La finance américaine, et donc mondiale, vit des moments dramatiques. Alors que le monde retient son souffle, il nous paraît utile de rappeler que, si capital et monde du travail ont souvent des intérêts opposés, voire contradictoires, il n'est pas dit que le second ne puisse peser sur le premier pour favoriser la prise en compte d'une plus grande responsabilité sociale.
Étude portant sur une proposition de définition d'une norme légale d'investissement socialement responsable
Définition d'un cadre normatif à l'investissement socialement responsable, basé sur les conventions internationales ratifiées par la Belgique, et dans l'objectif d'asseoir une cohérence et une exigence de qualité du marché ISR. Introduction Méthodologie Questions liminaires Les listes noires existant au niveau international Les conventions internationales La proposition d'une norme minimale Les résultats de la consultation Annexes
De la citoyenneté politique à la citoyenneté financière
Ce fondement religieux, qui n'a pas totalement disparu aujourd'hui, s'est arrimé, dans le contexte des Etats-Unis des années 70, à un fondement beaucoup plus large, davantage citoyen et politique, qui trouve son origine dans les bouleversements sociaux et culturels des années 60, en particulier les mouvements de lutte pour les droits civiques, les mouvements féministes, consuméristes, environnementalistes ou encore le mouvement de contestation contre la guerre au Vietnam. Ces préoccupations ont donné naissance à une véritable conscience publique au sujet des problèmes sociaux, environnementaux et économiques ainsi que de la responsabilité des entreprises à leur égard.
Cette évolution est parfaitement illustrée par une anecdote vécue, en 1967, par Luther Tyson et Jack Corbett qui travaillaient, à Washington, pour le Conseil de l'Eglise et la Société de l'Eglise méthodiste unie, sur des questions comme la paix, le logement et l'emploi. Tyson reçut une lettre d'une citoyenne de l'Ohio qui lui posait une question simple : "Existe-t-il un fonds commun de placement qui gère mon épargne-pension sans investir dans l'industrie militaire ?". Au terme d’une recherche bien menée, à sa plus grande surprise, Tyson dut faire l’amer constat qu’il n’existait pas de fonds répondant à cette exigence. Un an plus tard, retour de France où il s’était rendu en tant que membre d'une délégation surveillant les entretiens de paix de Paris qui ont permis de négocier la fin de la guerre du Vietnam, il décida qu'il était temps de créer des fonds qui répondent aux attentes de cette habitante de l'Ohio et de tous les autres investisseurs qui avaient les mêmes préoccupations qu’elle.1
C'est ainsi que Luther Tyson et Jack Corbett ont créé, en 1971, le Pax World Fund. Avec le Dreyfus Third Century Fund, créé l'année suivante, ce fut le premier fonds à proscrire l'énergie nucléaire et les contrats militaires de son portefeuille d’investissements. Ce fut aussi le premier fond à prendre en considération des critères sociaux dans sa gestion. Le Pax World Fund et le Third Century Fund marquent l’émergence de l’ISR au sein de la société civile et la prise en compte de critères extra-financiers, à caractère plus politique, dans la gestion financière. Cette tendance allait se confirmer avec le mouvement de lutte contre le régime de l'apartheid sévissant en Afrique du Sud.
Le boycott de l'Afrique du Sud de l'apartheid.
En 1973, la population noire d’Afrique du Sud a lancé, dans le cadre de sa lutte pour abolir l'apartheid, un appel à la communauté internationale afin qu'elle exerce diverses formes de boycott, de retrait d’investissement et de sanctions à l’égard du régime sud-africain.
Dès 1971, à l’initiative de l’un de ses nouveaux administrateurs — le Révérend Leon Sullivan, qui était le premier Noir américain nommé au conseil d’administration d’une multinationale —, une première résolution de vote, proposant la cessation des activités en Afrique du Sud, avait été soumise à l’assemblée générale de General Motors.
Parmi les nombreuses parties qui ont préparé le terrain pour que cesse l'apartheid en Afrique du Sud figure le mouvement de l'ISR, en particulier aux Etats-Unis. Ce mouvement débuta vers la fin des années 70, prit de l'ampleur tout au long des années 80 et eut pour effet que de nombreuses institutions retirèrent de leur portefeuille d'investissement les actions des sociétés qui ont continué à faire des affaires avec le régime raciste. Ce mouvement de désinvestissement a amplifié l'intérêt pour les fonds communs de placement investis de façon responsable.
La montée en puissance de cette campagne anti-apartheid s’est traduite par le départ de plus des deux tiers des entreprises américaines implantées en Afrique du Sud. Mais il aura fallu attendre 1993 pour que l’Assemblée générale de l’ONU lève finalement les sanctions économiques contre l’Afrique du Sud tout en maintenant l’embargo sur le pétrole et les armes, répondant ainsi à l’appel du président de Nelson Mandela, qui avait demandé la levée de ces sanctions, estimant que « le compte à rebours vers la démocratie » en Afrique du Sud avait commencé.
Cette victoire allait-elle mettre un terme à l'ISR fondé sur la défense des droits humains, voire à l'ISR tout court ? C'était en tout cas une opinion largement répandue à l'époque aux États-Unis. Il n'en a, pourtant, rien été puisque le rapport 1995 du Social Investment Forum (SIF) américain montrait notamment que 78 % environ des gestionnaires de fonds privés qui ont soutenu le démantèlement de la ségrégation en Afrique du Sud continuaient à gérer des portefeuilles ISR pour leurs clients deux ans après la fin de la campagne de désinvestissement.2
Par ailleurs, le mouvement anti-apartheid allait laisser d'autres traces tangibles en matière de responsabilité sociale des entreprises : en 1977, le Révérend Leon Sullivan édictait les « Sullivan Principles », code de conduite pour la promotion des droits de l’homme et de l’égalité des chances à destination des entreprises intervenant en Afrique du Sud. Vingt ans plus tard ils ont été révisés, élargis et rebaptisés Global Sullivan Principles for Corporate Responsibility, puis relancés par les Nations unies et un groupe de multinationales le 2 novembre 1999. Ils exigent des entreprises qu’elles contribuent à « promouvoir la justice économique, sociale et politique » là où elles opèrent.
En Belgique aussi, cette longue lutte de boycott et de désinvestissement des entreprises présentes en Afrique du Sud allait être à l'origine de réflexions et d'initiatives en matière d'éthique et de solidarité financière. C'est ainsi qu'à la fin des années 70 sont nées des initiatives d’épargne et de prêt de proximité, rapidement suivies de la création de structures comme Crédal et le Réseau Financement Alternatif et de leur homologues néerlandophones, Hefboom et Netwerk Vlaanderen.
La Birmanie est l'Afrique du Sud des années 90
On le voit, la préoccupation politique est désormais au coeur de la démarche d'investissement socialement responsable. Comment, en effet, concilier citoyenneté politique, fondée sur le vote démocratique, et citoyenneté financière, sinon en privant de financement les entreprises qui soutiennent directement ou indirectement des régimes non démocratiques?
C'est évidemment le cas de la Birmanie qui vit, depuis 1962, sous le joug d'une dictature militaire. En 1988, l'armée réprima violemment un mouvement de protestation contre la situation économique et politique en ouvrant le feu sur la foule qui protestait. La conséquence indirecte de ce mouvement fut qu'il permit la tenue d'élections en 1990. Elles virent la victoire de la NLD (National League for Democracy) dirigée par Aung San Suu Kyi mais elles furent annulées ensuite par la dictature militaire. Cela provoqua un scandale au niveau international. Suu Kyi reçut cette année-là le prix Sakharov et le prix Rafto puis le prix Nobel de la paix l’année suivante. Elle fut tour à tour emprisonnée, libérée puis assignée à résidence.
En 1993, lorsque l'Archevêque Desmond Tutu, qui avait reçu le Prix Nobel de la paix en 1984 pour son combat pacifiste contre le régime de l'apartheid, eut connaissance des brutalités commises par la junte contrôlant la Birmanie, il décrivit celle-ci comme « l'Afrique du Sud des années 90 ». Et de déclarer : « Il est temps aujourd'hui d'admettre que la politique de l'engagement constructif [avec le gouvernement militaire birman] est un échec (…). La pression internationale peut faire changer les choses. Ce furent des sanctions dures qui amenèrent finalement (…) l'aube d'une ère nouvelle dans mon pays. C'est là le langage qu'il convient de parler avec les tyrans, car c'est là, hélas, le seul qu'ils comprennent. »3
Aung San Suu Kyi elle-même lança divers appels en ce sens : « Je voudrais en appeler à ceux qui sont prêts à utiliser leurs talents pour promouvoir la liberté intellectuelle et les idéaux humanitaires, afin que, sur le principe, ils prennent position contre les entreprises qui font des affaires avec le régime militaire birman. Que votre liberté puisse servir la nôtre. »4
Ces appels ne sont pas restés sans réponse : des entreprises comme Pepsi, Levi's, Interbrew, Carlsberg, Heineken, Reebok, C&A, Hewlett-Packard, Ericsson, Adidas-Salomon, H&M, IKEA, Newmont ou British Petroleum ont choisi de se retirer de Birmanie. Mais il faut bien constater que d'autres multinationales, basées en Europe pour beaucoup, continuent à jouer un rôle clef dans l'appui à l'économie birmane qui finance la junte. Cinq des plus grands groupes bancaires présents en Belgique (Axa, DEXIA, Fortis, ING et KBC) investissent quant à eux massivement dans ces entreprises présentes en Birmanie, apportant ainsi un soutien financier (plus de 2,5 milliards $) à des entreprises qui soutiennent la junte militaire en place.5 Seule KBC a réagi en retirant, en avril 2006, TOTAL de ses fonds d'investissement éthiques.
26 communes belges se sont depuis lors émues de cette situation et ont voté une motion par laquelle elles nomment Aung San Suu Kyi citoyenne d’honneur de leur commune, interdisent tout investissement des finances communales ainsi que tout achat de produits d'entreprises actives en Birmanie et interpellent leurs banques pour qu’elles cessent d’investir dans les sociétés actives en Birmanie. 6
Le monde bancaire belge reste cependant sourd à ces appels et, par conséquent, les économies que chacun peut placer sur un compte d'épargne ou investir dans un fonds de placement continuent, au moins en partie, à soutenir les entreprises qui persistent à faire des affaires avec la junte birmane. A l'instar de la réaction citoyenne qui s'est développée en réaction au régime d'apartheid, la seule réponse possible est, ici aussi, de priver de financement les entreprises qui soutiennent directement ou indirectement la junte birmane en enjoignant aux banques d'arrêter immédiatement de financer ces entreprises avec nos dépôts. On le voit, la prise en compte de critères extra-financiers à caractère plus politique dans la gestion financière, initiée par Luther Tyson et Jack Corbett en 1971, reste plus que jamais d'une brûlante actualité et nécessité.
Bernard Bayot, avril 2007
2 Social Investment Forum, After South Africa, The State of Socially Responsible Investing in the United States, 1995
3 Desmond Tutu, Burma as South Africa, Far Eastern Economic Review, 16 septembre 1993
4 Le Monde, 10 décembre 1998
5 Netwerk Vlaanderen, Votre banque investit-elle en Birmanie?, février 2006, https://www.financite.be/gallery/documents/burma/mini-dossier-birma-fr-.pdf
6 Bruxelles-Ville, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Ixelles, Andenne, Remicourt, Rochefort, Mettet, Comblain-au-Pont, Dour, Alost, Schaerbeek, Huy, Gembloux, Zottegem, Nassogne, Gesves, Fléron, Anthisnes, Chaudfontaine, Baelen, Engis, Chastre, Nivelles, Dalhem, Watermael-Boitsfort, Gembloux
L'histoire de l'investissement socialement responsable (ISR) remonte à plusieurs siècles. Les investisseurs religieux de confession juive, chrétienne et islamique ainsi que de nombreuses cultures indigènes ont longtemps mêlé argent et morale, prenant en considération les conséquences de leurs actions économiques et refusant les investissements qui entraient en contradiction avec leurs conviction profondes.
Évolution sémantique de l'ISR
Introduction
Le développement sémantique d’un domaine constitue en général un bon indicateur de l’évolution du domaine en question. Les termes génériques des débuts se déclinent en termes plus spécifiques et nuancés pour migrer ensuite vers le langage commun. Prenons l’exemple du « commerce équitable », chacun comprend aujourd’hui de quoi il s’agit. Il n’en fut pas de même lors du lancement de ce concept. Il a d’abord dû se faire connaître, accepter et mettre en pratique pour, in fine, entrer dans le langage commun.
Qu'en est-il à ce jour du concept de l’investissement socialement responsable ? À la différence du commerce équitable, l’ISR comprend une diversité vaste et plurielle de pratiques financières, et, en l’absence de cadre juridique délimitant le concept, chaque institution financière, association ou fédération est libre d’en établir une définition propre.
D’aucuns parleront d’« investissements éthiques », d’autres d’« investissements durables », « socialement responsables », voire « soutenables ». Derrière ces variations sémantiques, que nous détaillerons par la suite, l’on retrouve toujours le même socle fondateur, généralement en phase avec l’évolution des préoccupations citoyennes : la prise en compte de considérations éthiques et sociales, au-delà des objectifs financiers traditionnels, dans les décisions d’investissement ou de placements1.
La définition de l’ISR reste imprécise par essence, « dans la mesure où elle repose sur l’idée de responsabilité sociale corporative, concept au cœur de débats et de perceptions diverses »2. De plus, l’éthique est loin d’être une notion absolue, celle-ci variant en fonction des cultures, des convictions, des époques et des lieux.
Toutefois si l’ISR est un concept en constante évolution – et ce, tant en Europe que dans les pays anglo-saxons – et si les termes pour le définir sont interchangeables, il nous paraît important de distinguer, quelle que soit la sémantique utilisée, l’investissement « éthique », qui porte un jugement moral ou de valeur, de l’investissement « socialement responsable », qui évoque les impacts sociétaux de tout investissement.
Genèse et évolution
L’intégration de critères autres que financiers dans les décisions d’investissement est apparue pour la première fois aux États-Unis, dans le courant du 19ème siècle, sous l’action des quakers américains qui refusaient d’investir dans les deux marchés les plus rentables de l’époque : l’armement et le commerce d’esclaves. Par la suite, le mouvement s’est perpétué à la suite de la pression exercée par les congrégations religieuses qui refusaient d’investir dans des actions « du péché », (les sin stocks), et qui excluaient d’emblée de leur politique d’investissement les entreprises actives dans l’alcool, le tabac, le jeu, l’armement et la pornographie. D’où l’origine du terme « investissementéthique ».
Progressivement les champs d’exclusion se sont élargis à d’autres secteurs d’activité, à d’autres zones géographiques et à d’autres investisseurs en fonction des nouvelles revendications de groupes de pression d’origines diverses : guerre du Vietnam et refus de financer l’industrie de l’armement ; régime de discrimination raciale en Afrique du Sud et boycott des investissements au nom de l’antiracisme ; catastrophes de Tchernobyl et de l’Exxon Valdez et lutte pour la protection de l’environnement.
Dans les années 1980, et à l'initiative d'un activiste américain, Léon Sullivan, le concept entre dans une nouvelle logique : en lieu et place d’exclure des entreprises en fonction de leurs activités, on s’intéresse davantage à leurs modes de fonctionnement, à leurs engagements vis-à-vis de la société. On les compare entre elles et on sélectionne celles qui affichent une réelle responsabilité sociétale. On parle donc d’« investissement socialement responsable ».
Le rapport Brundtland (1987), qui fait référence en termes de définition du développement durable, et le Sommet de la Terre de Rio (1992) ont largement contribué à renforcer l’évolution du concept qui, d’un instrument de boycott obéissant à une logique d’opposition, est devenu un moyen de tendre, positivement, vers un développement durable de notre société.
Les scandales financiers de ces dernières années – tout le monde a encore en mémoire le scandale d’Enron – n’ont fait que renforcer l’importance de la notion de responsabilité dans les actes financiers ainsi que dans le rôle d’actionnaire, où le concept d’activisme actionnarial, l'un des trois aspects de l’ISR, prend de l’ampleur.
De nos jours l’investissement éthique a donc fait place à l’investissement socialement responsable, voire même, depuis deux ans, à l’« investissement socialement responsable et durable(ISRD) ». L’ajout récent de ce dernier qualificatif traduit l’évolution du concept dans les pays anglo-saxons, où l’on parle de plus en plus de « socially responsible and sustainable investment (SRSI) ».
Au vu de ce qui précède, il est incontestable que le concept d’ISR évolue et évoluera encore. Depuis cette année, les termes « green and ethical investment »3, « green funds » ou « fonds thématiques ISR »4 font leur apparition. Nul doute que la problématique du changement climatique et de la protection de l’environnement influencera largement l’ISR au cours de ces prochaines années.
Ces éléments attestent donc le dynamisme et la richesse du concept de l'ISR. Mais ils montrent aussi que les professionnels de la finance se sentent suffisamment concernés par cette problématique pour vouloir participer à la définition de son cadre sémantique.
Cadre de l'ISR
Comme mentionné précédemment, l'investissement socialement responsable se définit au sens large comme toute forme d'investissement qui ne répond pas uniquement à des critères financiers, mais également à des préoccupations sociales, éthiques et environnementales.
En général, et de manière reconnue par la majorité des acteurs du secteur, les investissements responsables peuvent se classer selon trois grandes catégories :
- Selon une approche active, en fonction de l'engagement ou de l'activisme actionnarial auprès des entreprises du portefeuille de placement. « L'activisme actionnarial consiste à exercer son pouvoir d'actionnaire, par le biais de son droit de vote, aux assemblées générales des entreprises cotées en Bourse afin d'améliorer le comportement éthique, social et/ou écologique de l'entreprise dont on est actionnaire, en favorisant le dialogue avec les dirigeants, en exerçant des pressions, en soutenant une gestion responsable, en proposant et en soumettant au vote des assemblées générales annuelles des préoccupations sociétales »5.
- Selon une approche passive, en fonction de l'application de filtres positifs ou négatifs sur la base de critères éthiques, sociaux ou environnementaux, au moment du choix de placement. On parle dès lors de « screening » ou « tamisage positif ou négatif de l'univers d'investissement ».
Le « screening négatif » ou « screening d'exclusion » consiste à exclure de son univers d'investissement des entreprises impliquées dans certains secteurs d'activités ou produits et services. De nos jours les secteurs qui sont remis en question sont généralement : l'armement, l'énergie nucléaire, le tabac, l'alcool, le pétrole, etc. Les pays qui posent problème sont les pays non démocratiques, non respectueux des droits de l'Homme, des conventions de l'OIT. Quant aux pratiques réputées sensibles, citons, à titre d’exemples, les manipulations génétiques, les tests sur les animaux, les OGM…
L'exclusion sera soit globale, exclusion de l’ensemble du secteur d'activité ou exclusion géographique, soit nuancée, par exemple, exclusion des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires proviennent de la vente d'armes.
A contrario, le « screening positif » ou « screening d'inclusion » vise à inclure dans l'univers d'investissement les entreprises qui affichent des pratiques exemplaires ou, du moins, qui adoptent les meilleures pratiques de leur catégorie (Best in Class) ou qui apportent une contribution signification au développement durable, par exemple.
- Selon une approche communautaire (ou solidaire ou de partage) en fonction des investissements communautaires ou des investissements dits « solidaires » ou dits « de partage ». On sélectionne, ici, les produits financiers de différentes formesqui visent à fournir du capital en prêtant à des entreprises locales ou à des particuliers ou en faisant des investissements sous forme de participation dans de telles entreprises en vue de favoriser le développement communautaire ou d’appuyer les groupes défavorisés ou à faibles revenus ou de développer l'économie locale, sociale.
C'est très certainement dans cette dernière catégorie que l'on retrouve le plus d'hétérogénéité entre les pays. La richesse et la multiplicité des outils financiers développés de par le monde en vue de répondre au réel besoin de financement de l'économie sociale fait qu'il est difficile de se limiter à trois catégories pour définir l'ISR. La Belgique et la France ont des spécificités ISR qui se regroupent au sein d'une quatrième catégorie appelée « placement de partage ». Le Canada définit quant à lui l'ISR en six catégories, ajoutant ainsi aux quatre catégories évoquées ci-dessus des prêts responsables et du capital risque soutenant le développement durable6. D'autres préféreront parler de « finance socialement responsable » afin de pouvoir marquer clairement la distinction entre les deux types de pratiques que sont les placements, d’une part, et les investissements, d’autre part7.
Sans parler des nuances de terminologie entre les notions anglo-saxonnes de « charity », « communit »y, « local economy » et celles, francophones, de « partage », « solidaire », « social ».
Pour avoir une vue exhaustive de ces différentes notions, il serait nécessaire de consacrer tout un article la sémantique de la finance solidaire. Ce qui n'est pas l'objet premier de cette analyse.
Néanmoins, notons que l'Europe a songé tout récemment à créer un label qui définit les critères pour les produits financiers solidaires. Outil précieux sans nul doute qui permettra, d'une part, d'éclairer le consommateur, et, d'autre part, de ne pas mettre le solidaire à toutes les sauces.
Conclusion
Indépendamment des questions de sémantique, l'investissement socialement responsable est un concept important : il permet d'agir sur les pratiques des grandes entreprises, de ramener l'économie mondialisée et de plus en plus distante des préoccupations de la société dans un champ plus citoyen, de dégager par le biais de ses investissements communautaires du capital de développement, indispensable pour un développement harmonieux de l'ensemble de notre société. Il permet de reconstruire le lien, oublié dans cette mondialisation financière, entre l'investisseur et le projet de développement.
La mise en place d'un cadre définissant de manière légale l'investissement responsable devient peut-être une réelle nécessité. Les professionnels de la finance ne sont pas prêts à l’admettre, arguant que délimiter l'investissement responsable viendrait à réduire le concept et à empêcher son évolution. Ce n'est pas faux mais, a contrario, étiqueter des produits financiers ISR alors qu'ils n'ont strictement rien d'ISR en dehors de leur nom pose un réel problème, du même ordre que la vague greenwashing8 qui déferle en ce moment sur notre société.
La mise en place d'un cadre légal, aussi large fût-il, permettrait déjà de préserver l'ISR de dérives commerciales et d'ainsi garantir la pérennité du concept.
Alexandra Demoustiez, octobre 2007
Références:
- Bourque, Gendron, « La finance responsable : la nouvelle dynamique d’une finance plurielle ? », in Economie et Solidarités, volume 34, numéro 1, 2003.
- Association canadienne pour l'Investissement Responsable (AIR), : La revue 2004 de l'Investissement responsable au Canada.
- Novethic Etudes, Les nouveaux territoires de l'ISR : les investissements verts qui se réclament de l'ISR, octobre 2007
- Bayot, Demoustiez, L'investissement socialement responsable en Belgique – rapport 2004, Réseau Financement Alternatif, juin 2004.
- Jean-Jacques Rosé, Responsabilité sociale de l'entreprise, De Boeck Université, 2006
1 L’investissement socialement responsable vient, à l’origine, du terme anglo-saxon « SociallyResponsible Investment » dans lequel le terme « investment » désigne tant les activités d’investissement que de placement. Dans le cadre de cette analyse, nous utiliserons également le terme « investissement » pour désigner à la fois l’investissement et le placement.
2 Bourque, Gendron, « La finance responsable : la nouvelle dynamique d’une finance plurielle ? », in Économie et Solidarités, volume 34, numéro 1, 2003 p. 21 à 36.
3 Henderson
4 " Les fonds thématiques ISR se définissent principalement par des choix d'investissement dans des secteurs d'activité proposant des solutions en faveur d'un développement durable.", in Novethic Etudes, Les nouveaux territoires de l'ISR : les investissements verts qui se réclament de l'ISR, octobre 2007.: p. 3.
5 Bayot, Demoustiez, L’investissement socialement responsable en Belgique - rapport 2004, Réseau Financement Alterntif, juin 2004, p. 13.
6 Association canadienne pour l'Investissement Responsable (AIR), La revue 2004 de l'Investissement responsable au Canada..
7 Bourque, Gendron, op.cit., p.25.
8 Terme anglophone pouvant être traduit par « verdissement d'image ». Il est utilisé par les groupes de pression environnementaux pour désigner les efforts de communication des entreprises sur leurs avancées en termes de développement durable – avancées qui ne sont pas accompagnées d'action véritable. Ce terme est également utilisé pour désigner le rapprochement d’une entreprise avec l'ONU dans le cadre du Global Compact.
L'investissement éthique, l'investissement socialement responsable, durable, soutenable... que de termes pour qualifier un même concept, à savoir, la prise en compte de critères extrafinanciers lors d'un choix de placement ou d'investissement. Mais derrière chacune de ces variantes se profile une nuance. Prenons le temps de les examiner.
État des lieux des initiatives socialement responsables des institutions financières
Introduction
Les institutions financières multiplient, depuis quelques années, les initiatives volontaires afin d'améliorer leur responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, on peut en dénombrer sept principales, allant de l'élaboration de lignes directrices en termes de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et le financement du terrorisme – Wolfsberg Principles – à une standardisation des bonnes pratiques en matière de transparence – Global Reporting Initiative – ou à une collecte d'information sur l'empreinte écologique des entreprises détenues en portefeuille – Carbon Disclosure Project. Comme nous le verrons en détail par la suite, les domaines sont donc vastes, variés et complexes. Toutes ces initiatives, louables en soi, nécessitent, pour devenir réellement efficaces et espérer déboucher sur un changement significatif, un réel engagement en interne et la mise en place de sérieuses procédures de suivi de la part de l'institution bancaire. Et c'est malheureusement là que très souvent le bât blesse.
L'objectif de cette analyse est de réaliser un état des lieux des sept principales initiatives bancaires en termes de responsabilité sociétale, de porter un regard critique sur leur efficacité pour amener in fine le débat à la question : initiative volontaire ou réglementation du marché financier ?
État des lieux
Global Reporting Initiative (GRI)
Créé en 1997, le Global Reporting Initiative, comme son nom l’indique, poursuit l’objectif de standardiser les bonnes pratiques en matière de transparence et de reporting. Il s’est donné pour mission de développer, en partenariat avec différents groupes d’acteurs et d’experts, un référentiel en matière de reporting social et environnemental– Sustainability Reporting. Le GRI définit les principes et indicateurs qu’une organisation (entreprise privée ou publique, ONG, association, sprl...) peut utiliser pour mesurer et rendre compte de ses performances économiques, sociales et environnementales. En 2006, le GRI a édité sa troisième version de lignes directrices dénommée G3 Guidelines.
En développant un référentiel en matière de reporting économique, social et environnemental, le GRI permet de stimuler la demande pour de l’information « durable » (sustainable development), d’accroître la qualité de l’information ainsi que de faciliter les comparaisons intersectorielles.
Carbon Disclosure Project (CDP)
Lancé en 2000, le Carbon Disclosure Project (projet de publication volontaire des émissions de dioxine de carbone – CO2) regroupe, aujourd'hui, plus de 300 investisseurs institutionnels qui gèrent, au total, plus de 40 milliards de dollars d'actifs. L'objectif du projet est de fournir à ses membres des informations essentielles et souvent difficiles à obtenir concernant la stratégie en matière de changements climatiques et d'émissions de gaz à effet de serre des entreprises dans lesquelles ils investissent, et ce, afin de leur permettre d'évaluer les risques et opportunités liés aux changements climatiques. Pour récolter ces informations, le CDP, par le biais de ses membres, mène chaque année une enquête sur la base d'un questionnaire en dix points. La première édition, menée en 2000, portait sur les 500 premières entreprises mondiales (FT500). Depuis, le taux de réponse n'a cessé d'augmenter et l'univers de s'élargir pour arriver aujourd'hui à plus de 2000 entreprises interrogées.
L'atout de cette initiative : conscientiser le secteur bancaire et le monde des entreprises aux changements climatiques et encourager les entreprises à calculer et réduire leur empreinte écologique.
Ses limites : plus de 20 % des premières entreprises mondiales par capitalisation boursière (FT500) refusent toujours de publier leurs émissions de gaz à effet de serre. Se pose également une question de crédibilité étant donné qu'aucun organisme indépendant ne valide ni ne certifie les données récoltées.
Les principes de l'Équateur (Equator Principles - EP)
Les principes de l’Équateur sont un ensemble de dix principes calqués sur les standards environnementaux et sociaux de l'International Finance Corporation visant à permettre aux institutions financières une gestion saine des problèmes sociaux et environnementaux liés au financement de projets.
L'objectif des EP, pour les établissements financiers signataires, consiste à s'assurer que les projets qu'ils financent, et particulièrement ceux qu'ils financent dans les pays et marchés émergents, sont réalisés en tenant compte de critères sociaux et environnementaux.
Ils servent de base pour la mise en œuvre, par chaque institution financière signataire, de ses propres politiques, procédures, normes internes. Depuis le lancement en 2003, les EP sont adoptées à ce jour par plus de cinquante institutions financières internationales.
L'atout de cette initiative : rationaliser, de par la création de ce réseau international, la gestion de risque social et environnemental ainsi qu'harmoniser les exigences sociales et environnementales en termes de financement de projets.
Ses principales limites : la question de la gestion et de la bonne gouvernance des « banques d'Équateur ». Une des faiblesses souvent évoquées à l’égard des EP réside dans le fait que les banques d’Équateur ne disposent pas, d’une part, d’un réel mécanisme de gouvernance et, d’autre part, ne constituent pas un consortium solide. La mise en place d’un mécanisme de gouvernance, via une fonction de coordination appuyée par des politiques et des critères, permettrait à tout le moins de garantir l’intégrité de l’initiative volontaire de chaque banque signataire, de maintenir ainsi un contrôle de qualité minimum et d’assurer le développement des EP à terme.
United Nations Global Compact (ou le Pacte mondial)
Il s’agit d’un ensemble de dix principes qui engagent, sur base volontaire, les entreprises signataires à respecter et promouvoir, dans leurs stratégies et opérations, le respect des droits de l’Homme, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.
« En termes de droits de l’homme : (1) elles sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence ; et (2) à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’homme. En termes de droit du travail : elles se doivent de respecter (3) la liberté d’association et le droit de négociation collective, (4) l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, (5) l’abolition effective du travail des enfants ; et (6) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. Sur le plan environnemental, elles sont invitées à (7) appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant l’environnement, (8) à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement, ainsi qu’à (9) favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement. En matière de lutte contre la corruption, elles sont invitées (10) à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les pots de vin. »
Depuis son lancement officiel, le 26 juillet 2000, l’initiative concerne actuellement plus de 5 600 signataires répartis dans 120 pays. Elle s’adresse aux entreprises et organisations les plus diverses, et souhaite favoriser, de par sa structure volontaire et en réseau, la participation au processus de diverses parties prenantes de la société civile et promouvoir ainsi l’interaction et l’échange de bonnes pratiques. Plusieurs mécanismes tels que la concertation, l’apprentissage, la mise en place de réseaux locaux et les partenariats sont proposés en vue de faciliter la mise en pratique du pacte.
Les critiques les plus souvent émises à l’égard de l’initiative proviennent principalement de la faiblesse de son système de reporting ; de sa pénétration limitée sur le marché, essentiellement auprès des grandes compagnies d’Europe de l’Ouest ; et de la nécessité de définir des critères plus précis, moins amples, afin de pouvoir, d’une part, les appliquer concrètement, et, d’autre part, initier un réel changement des comportements entrepreneuriaux.
Les Principes Wolfsberg
Fondé en 2000, le Wolfsberg Groupe est une association de onze établissements financiers d’importance internationale qui se sont accordés sur un ensemble de directives mondiales pour la lutte contre le blanchiment d’argent, la corruption et la répression du financement du terrorisme. Leur volonté est de développer des normes et des références adéquates pour les institutions financières.
La première directive définie concerne les directives mondiales anti-blanchiment pour les services bancaires privés, dont l’objectif est de prévenir l’utilisation de leurs opérations internationales à des fins illicites, via, entre autres, des procédures de vérification internes dans l’acceptation du client. Ces directives ont ensuite été traduites pour les banques correspondantes.
En matière de prévention contre le terrorisme, la Déclaration de Wolfsberg sur la répression du financement du terrorisme de 2002 définit, quant à elle, des lignes de conduite aux institutions financières qui, par le biais de la prévention, de la détection et du partage des informations, peuvent aider les gouvernements et organismes publics à lutter contre le terrorisme.
Tous ces textes reconnaissent la nécessité d’un contrôle approprié des transactions et des clients mais ne traitent nullement des questions relatives à l’élaboration et à la mise en place de telles procédures. C’est chose faite, via la Déclaration sur la surveillance, le filtrage et la recherche qui aborde ce point en déterminant les questions à aborder afin d’être en mesure de développer de telles procédures.
Ces mesures volontaires sont certainement utiles pour pallier des déficiences dans des domaines régis par des législateurs ou régulateurs. Néanmoins, en Europe, la directive du 4 décembre 2001 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux assure une réglementation stricte en la matière.
Initiative de transparence des industries extractives - Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)
Initiative lancée en 2002 au sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg par le premier Ministre britannique Tony Blair et largement soutenue par le G8, elle vise à accroître la transparence des paiements des industries extractives (Pétrole, Gaz, industries minières) effectués auprès des gouvernements des pays riches en ressources naturelles. L’exploitation de ces ressources minières par les compagnies génère des revenus sous formes de royalties, taxes, primes à la signature des contrats d’exploitation et d’autres formes de paiements auprès des gouvernements locaux. Ces revenus devraient contribuer à la croissance économique et au développement social de ces pays. Malheureusement, le manque de transparence lors des transactions financières peut exacerber des pratiques de mauvaise gouvernance et aboutir à des cas de corruption, de conflit ainsi que de pauvreté.
Le mécanisme est simple : encourager la publication, par les Etats, des recettes perçues au titre de l’exploitation de ces ressources naturelles et, par les entreprises, des paiements effectués aux Etats. Parallèlement, la mise en place d’un mécanisme de réconciliation de ces données permet de s’assurer de la concordance entre les recettes perçues par les Etats et les paiements effectués par les entreprises.
Les institutions financières et investisseurs institutionnels peuvent encourager cette initiative en adhérant à la Déclaration des investisseurs sur la transparence dans le secteur de l’extraction. Par cette adhésion, les institutions financières s’engagent à soutenir les principes de transparence de l’EITI en demandant aux entreprises dans lesquelles elles investissent de soutenir et de promouvoir activement les principes de l’EITI.
La coalition internationale « Publiez ce que vous payez » souligne l’importance de cette initiative et les développements encourageants qu’elle entraine auprès d’institutions financières internationales telles que le FMI, la Banque Mondiale et la BERD. Néanmoins, elle relève deux points critiques d’importance : D’une part, la question de l’approche tripartite de l’EITI entre le gouvernement, l’industrie et la société civile et qu’il serait plus judicieux que l’entreprise divulgue individuellement l’information concernant leurs paiements afin de permettre un contrôle efficace de la publication des données et éviter ainsi les pressions exercées par le gouvernement. D’autre part, la question de l’approche volontaire, pays par pays, car l’initiative risque de ne pas s’appliquer aux pays qui ont le plus besoin de transparence en la matière. Les élites au pouvoir profitant de la gestion secrète des revenus provenant des ressources naturelles sont peu susceptibles de s’engager sur base volontaire.
Principes pour l’Investissement Responsable - United Nations Principles for Responsible Investment (PRI)
Lancé en 2006 sous l’égide de l’UNEP-FI et du Global Compact, les Principes pour l’Investissement Responsable visent à intégrer les problématiques environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans la gestion des portefeuilles d’investissement.
Le PRI est composé de 6 principes, déclinés en une série de 35 actions concrètes possibles pour guider les investisseurs à mettre les principes en place. Ils consistent à (1) intégrer les problématiques ESG dans l’analyse et les décisions d’investissement ; (2) devenir investisseur actif et prendre en compte les questions ESG dans les politiques et pratiques actionnariales – via la politique des droits de vote par exemple ; (3) demander aux entités dans lesquelles elles investissent de publier des informations appropriées sur les questions ESG ; (4) favoriser l’acceptation et l’application des principes dans le secteur de l’investissement ; (5) travailler ensemble afin d’accroître l’efficacité dans la mise en application de ces principes ; (6) rendre compte à titre individuel des activités et des progrès réalisés dans l’application de ces principes.
Les PRI, comme toutes les initiatives mentionnées ci-dessus, relèvent d’un engagement volontaire, non obligatoire de la part des institutions financières et certes la question de l’efficacité, du suivi, du contrôle et de l’impact réel se pose à nouveau. Néanmoins, l’atout de ces principes réside essentiellement dans le fait qu’ils fournissent une reconnaissance officielle aux questions ESG dans le secteur financier et qu’ils concernent la totalité des actifs financiers au-delà du champ de l’Investissement Socialement Responsable.
Social Investment Organisation (SIO), un organisation qui promeut l’Investissement Socialement Responsable au Canada souligne que « sans la pression des actionnaires les principes n’aboutiront pas in fine à de grands changements. Le PRI étant basé sur les procédures plutôt que sur les revenus proprement dits, il laisse la porte ouverte aux investisseurs de les signer sans devoir changer d’un dollar leurs portefeuilles d’investissement, donnant ainsi l’impression de changement, plutôt qu’un réel changement ».
Conclusion
Au regard de l’ensemble de ces initiatives volontaires, il est incontestable que la question de la responsabilité sociale et environnementale ne peut plus être et n’est plus ignorée par le monde financier. Elles démontrent la prise de conscience du rôle des institutions financières vis-à-vis de la société actuelle et future et apporte une reconnaissance officielle aux questions environnementales, sociales et de gouvernance. Cet élément justifie à lui seul pleinement leur existence.
Le mouvement est donc initié. Néanmoins après le lancement de la première initiative il y a 11 ans, n’est-il pas temps de se poser la question de leur efficacité ? Et d’ouvrir à nouveau le débat sur la question : initiative volontaire ou réglementation du marché financier ? Les associations et organisations non gouvernementales actives en la matière portent un regard de plus en plus sceptique quant à l’efficacité des démarches volontaires. Celles-ci se multiplient mais les résultats sont faibles et les changements peu perceptibles. Souvent instrumentalisées à des fins de communication, peu contraignantes, elles passent fréquemment à la trappe face aux obligations de rendement et autres obligations financières. L’adage n’est-il pas : Chassez le naturel, il revient au galop. Pour qu’une démarche volontaire mène à un réel changement, l’initiative nécessite un engagement, et ce à tous les niveaux en interne. Elle doit s’intégrer dans le core business de l’institution, être acceptée, assimilée, acquise par tous et non circonscrite à un département extra-financier qui s’occupe des questions de responsabilité sociale et environnementale. De sérieuses procédures de contrôle et de suivi se doivent d’être mises en place. Or très souvent elles sont absentes. Un rapport de l’OCDE sur la question des approches volontaires pour les politiques environnementales concluait que l’efficacité environnementale des approches volontaires est bien souvent questionnable et leur efficacité économique généralement faible.
Carbon Disclosure project 2006, Enquête menée auprès des entreprises du SBF120, p.17.
Pour plus d'information sur les principes de l'Équateur, se reporter à l'analyse " Les principes de l'Équateur", Alexandra DEMOUSTIEZ, Réseau Financement Alternatif, septembre 2007.
Par financement de projet, on entend un « mode de financement dans lequel le prêteur considère avant tout les revenus générés par un projet à la fois comme source de remboursement de son prêt et comme sûreté attachée à son exposition. Ce type de financement concerne donc généralement de vastes projets complexes et onéreux tels que centrales électriques, usines chimiques, mines, infrastructures de transport, environnement et télécommunications. » (Source : Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres – Dispositif révisé(« Bâle II »), novembre 2005, http://www.bis.org/publ/bcbs107fre.pdf).
Les dix principes sont issus des conventions internationales suivantes : Déclaration universelle des droits de l’homme, Déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, conventions des Nations unies contre la corruption.
Nom de la localité suisse où s’est tenue la séance de travail visant à définir ces directives.
Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays, Citigroup, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, UBS.
Par « banques correspondantes », on entend : les banques, maisons de courtage, fonds mutuels, sociétés d’investissement à capital variable, fonds de pension, sociétés de financement des ventes à tempérament, etc.
France Diplomatie – l’initiative pour la transparence dans les industries extractives – juin 2007
Publish what you pay – est une coalition internationale regroupant plus de 200 ONG et qui appel à l’entière transparence des paiements des compagnies minières, pétrolières et gazières de tous les gouvernements nationaux. www.publishwhatyoupay.org
UNEP-FI : unité du PNUE visant à encourager l’adoption de meilleures pratiques environnementales par les professionnels de la finance. www.unepfi.org
Ethical Corporation – North America: The Principles of Responsible Investment: Time to step up to the mark. http://www.ethicalcorp.com/content.asp?ContentID=4354
Les institutions financières de par le monde adoptent, sur base volontaire, une série d'initiatives en vue d'améliorer leur responsabilité sociale et environnementale.
Pagination
- Page précédente
- Page 65
- Page suivante